Selon la haute juridiction administrative (Conseil d’Etat, 6e et 5e chambres réunies, 30 avril 2024 n°465919), les personnes publiques mentionnées par l’article L.221-1 du Code de l’urbanisme peuvent acquérir des immeubles par voie d’expropriation afin de constituer des réserves foncières sous deux conditions :
- D’une part, elles doivent justifier « à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique est engagée, de l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme » (mise en œuvre d’un projet urbain ou d’une politique locale de l’habitat, maintien des activités économiques, désartificialisation des sols…) ;
- D’autre part « si le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé ».
Une telle acquisition par voie d’expropriation est possible selon les termes de l’arrêt susvisé du Conseil d’Etat « alors même que les caractéristiques de ce projet n’auraient pas encore été définies à cette date ».
En l’espèce, par un arrêté du 31 août 2018, la préfète de la Charente avait déclaré d’utilité publique un projet de requalification d’une friche industrielle et autorisé un établissement public foncier à procéder aux acquisitions nécessaires à la réalisation future de l’opération.
Le tribunal administratif de Poitiers avait annulé pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral.
La Cour administrative d’appel avait quant à elle rejeté les appels formés contre ce jugement, retenant que « la commune d'Angoulême et la communauté d'agglomération ne justifiaient, à la date d'engagement de la procédure de déclaration d'utilité publique, malgré leur objectif affirmé de requalification de cette zone actuellement en état de friche polluée et très dégradée, d'aucun projet d'action ou d'opération d'aménagement défini même dans ses grandes lignes […] ».
Or, selon le Conseil d’Etat, la commune et la communauté d’agglomération avaient entendu réserver le terrain pour « permettre la réalisation d'une opération de renouvellement urbain afin, d'une part, de résorber une friche industrielle à l'entrée de la ville présentant un danger avéré pour les habitants et, d'autre part, de développer de nouvelles zones d'activité économique ainsi qu'une offre de logements familiaux à loyer abordable, conformément à la vocation de la zone telle que modifiée par le plan local d'urbanisme intercommunal alors en cours d'élaboration et adopté en décembre 2019 » ; peu important dans ce cas que la consistance de ce projet « n’était alors définie que de manière sommaire, sans que la répartition entre ses composantes de développement économique et d’habitat n’aient encore été arrêtées ».
En effet, le site était pollué, il était donc nécessaire, selon la haute juridiction administrative « de disposer de la maîtrise foncière pour préciser ce programme d’aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et actions de dépollution ».
En définitive, le Conseil d’Etat, dans cet arrêt, tient compte de la particularité des réserves foncières « dont l’objet n’est pas de réaliser mais seulement d’anticiper la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement » (Conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public, arrêt n°465919, Communauté d’agglomération d’Angoulême).
Il faut relever qu’une telle solution avait déjà été dégagée par le Conseil d’Etat en 2014 (CE, 21 mai 2014 n°354804, Communauté d’agglomération de Montpellier).
Enfin, ce raisonnement apparaît tout à fait similaire à celui qui prévaut en matière de préemption (CE, Commune de Meung-sur-Loire, 7 mars 2008, n°288371), et ce, notamment lorsque la préemption est réalisée pour constituer des réserves foncières, ; en ce sens :
« […] le titulaire du droit de préemption urbain peut légalement exercer ce droit, d'une part, s'il justifie, à la date à laquelle il l'exerce, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'il fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption » (Conseil d’Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 20 novembre 2009, n°316732).
Cet arrêt témoigne donc des multiples similarités pouvant exister entre la procédure de préemption et celle de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lesquelles procédures peuvent toutes deux permettre aux collectivités de constituer des réserves foncières, sous certaines conditions.
Aurélia MICHINOT - Juriste
Ronan BLANQUET - Avocat Associé
Maître Ronan Blanquet et son équipe se tiennent à votre disposition pour :
- Vous éclairez sur vos droits ;
- Sécuriser juridiquement vos projets et les faire aboutir ;
- Défendre vos intérêts en négociations ou au contentieux ;
- Agir dans les recours indemnitaires liés aux actions de l’administration.
cabinet@adicea-avocats.fr – 02.22.66.97.87.


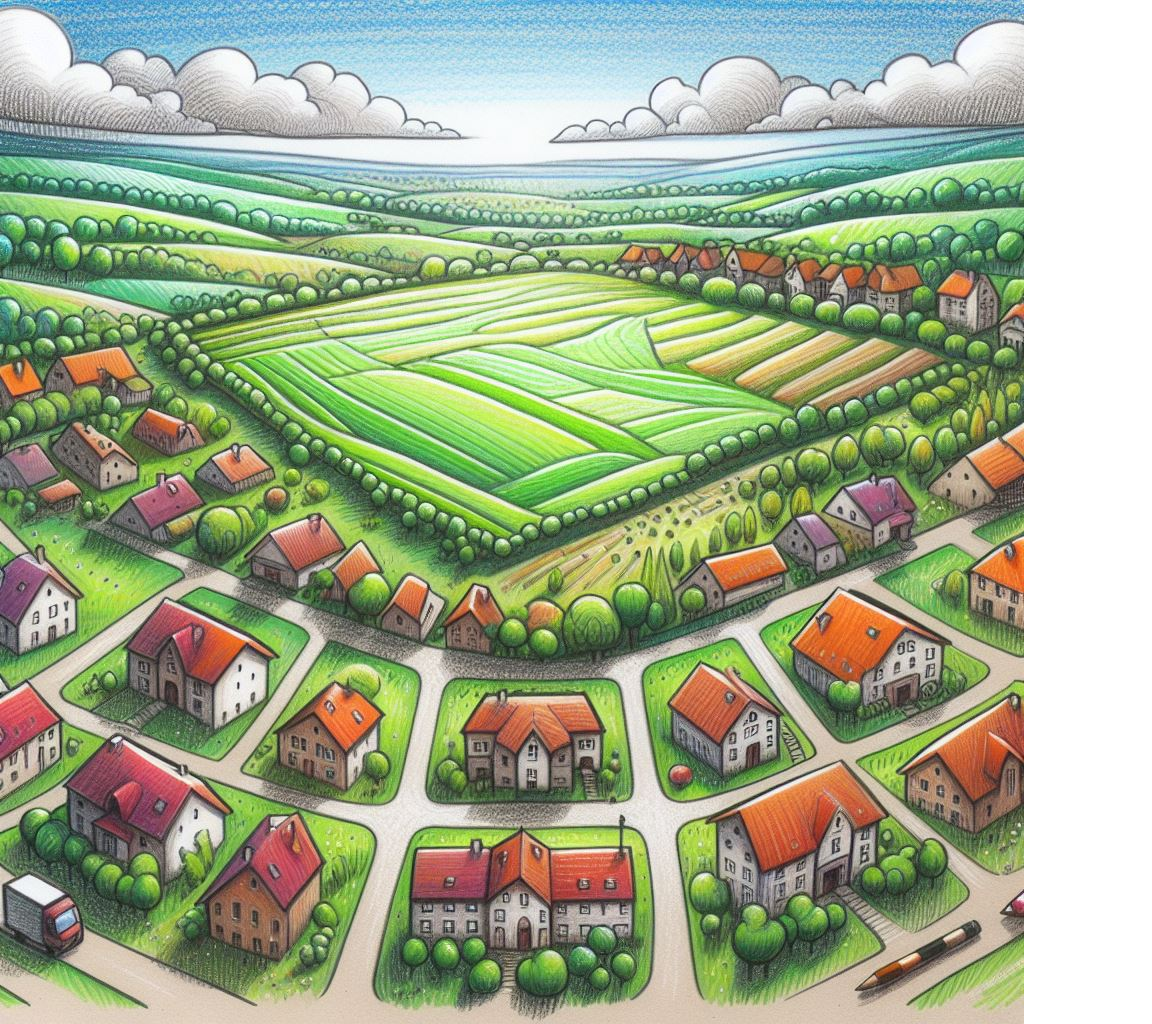
Pas de contribution, soyez le premier