CA Papeete, 2 août 2017, n° 17/8, JD 2017-017002
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (art. 51), les honoraires de l’avocat sont fixés en accord avec le client, aux termes d’une convention d’honoraires écrite (6°) « qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ». Il ne peut en être autrement qu’« en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il [l’avocat] intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ».
La Cour d’appel de Papeete juge, dans l’arrêt rapporté, que la loi du 6 août 2015 précitée est bien entrée en vigueur le 8 août 2015 en Polynésie française. A cela, il n’y a rien d’étonnant. La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française réserve bien à l’État, en son article 14, la compétence relative à l’organisation de la profession d'avocat.
La cour juge aussi qu’il s’est écoulé huit mois entre la date d’entrée en vigueur du texte précité et le premier entretien entre l’avocat et son client. Par ailleurs, la simple rédaction d’un reçu n’est pas une convention, car ce reçu « n’indique ni le montant ni le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ni les divers frais et débours envisagés… ». Dès lors, la contestation d’honoraires élevée par les clients est reçue par la cour qui décide qu’ils « ne sont tenus au versement d’aucun honoraire envers leur avocat ».
Autant dire que cette décision apparaît excessivement rigoureuse aux yeux des membres de la profession concernée, et ce, pour les deux raisons suivantes :
Premièrement, la loi n° 2015-990 précitée ne prévoit pas expressément, pour sanction de son inexécution, la perte du droit à toute rémunération.
Deuxièmement, l’avocat ne recevra dès lors aucune rémunération, alors qu’il a pourtant accompli des diligences, c’est-à-dire un travail effectif.
Dura lex, sex lex !
Certes, mais l’on sait bien que la loi excessivement dure est une loi injuste. Elle n’est satisfaisante que dans l’abstraction. Confrontée à la réalité, elle s’avère contraire à l’équité. Faut-il rappeler la décision du « bon juge » Magnaud de Château-Thierry qui, dans l’affaire Ménard du 4 mars 1898, décide que « le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi » ?
Dans le cas présent, l’injustice ne se révèle pas seulement à propos de la situation d’espèce, à qui il manque l’indispensable adaptation humaine. L’injustice s’exerce aussi aux dépens de la collectivité des avocats, qui est tenue à l’écart d’un principe pourtant fondamental : celui de la juste rémunération du travail accompli.



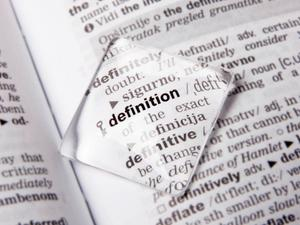
Pas de contribution, soyez le premier