Le déféré préfectoral : délai, effet, comment réagir ?
Que l’on soit une collectivité territoriale (commune, communauté de communes, etc.) ou le bénéficiaire d’une autorisation administratif, apprendre que le préfet a déféré une décision administrative au tribunal administratif est toujours alarmant : pourquoi le représentant de l’Etat dans le département conteste-t-il cette décision ?
Figure de proue des autorités déconcentrées et autrefois détenteur d’un large pouvoir au niveau local, le préfet a vu ses pouvoirs évoluer dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales. Il continue néanmoins d’exercer un contrôle a posteriori sur les actes de ces dernières par le biais du déféré préfectoral.
Le déféré préfectoral constitue une prérogative du préfet de département. En somme, le préfet défère au tribunal administratif les actes des collectivités qu’il estime contraires à la légalité (CE, 30 janvier 1987, COREP d’Ille-et-Vilaine c/ Cne du Rheu, n°70777).
En matière d’urbanisme, lorsque le préfet décide de déférer, cela peut autant impacter le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme que la commune ayant délivré l’acte.
A ce titre, le déféré peut porter sur les autorisations d’urbanisme et certificat d’urbanisme délivrés par le maire (ou le président de l’EPCI) qui ont été transmis au préfet du département, mais également sur toute une série d’actes visés par l’article L2131-2 du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT)).
Le préfet bénéficie d’un statut privilégié par rapport aux autres requérants, si en principe il se saisi de lui-même (1), il peut également déféré un acte à la demande de tiers (2)
- Cadre général : recours gracieux et saisine du tribunal administratif
1.1. Le recours gracieux
En premier lieu, et lorsqu’il constate qu’un acte d’une collectivité est entaché d’illégalités, le préfet a la faculté de former un recours gracieux auprès de l’autorité qui a délivré l’autorisation d’urbanisme afin de solliciter son retrait ou sa réformation (CE, 24 janvier 1994, Préfet de l’Hérault, n°124308).
Ce recours prend la forme d’une lettre d’observations indiquant les illégalités constatées et doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l’acte en question au préfet.
Lorsque le préfet décide, au préalable, de former un recours gracieux (qui est, pour rappel, facultatif) contre une autorisation d’urbanisme, il a l’obligation de le notifier au titulaire de l’autorisation (R. 600-1 code de l’urbanisme (ci-après CU)).
Le recours gracieux formé par le préfet empêche l’acte de devenir définitif :
- À compter de la décision de rejet du recours gracieux par la collectivité, le préfet dispose d’un nouveau délai de recours contentieux de deux mois pour déférer l’acte au tribunal administratif ;
- En cas de transmission incomplète de documents relatif à l’acte illégal, le préfet peut solliciter la communication de documents complémentaires qui, sous réserve que ladite communication soit nécessaire, fait recourir le délai de recours contentieux à compter de la réception desdits documents (CE, sect., 13 janvier 1988, n°68166 et CE, 31 mars 1989, 83329).
- En cas de refus de la collectivité, le préfet peut déférer l’acte devant le tribunal administratif.
1.2. La saisine du tribunal administratif
Le déféré préfectoral devant le tribunal administratif prend plusieurs formes dont celui de recours en annulation (CE, 27 février 1987, Cne de Grand-Bourg de Marie-Galante c/Mme Pistol, n°54847).
En ce sens, le préfet qui défère devant le tribunal un acte qu’il estime illégal énonce dans sa requête les moyens qui justifie l’annulation de l’autorisation ou du certificat d’urbanisme (CE, 27 février 1987, Cne de Grand-Bourg de Marie-Galante c/Mme Pistol, n°54847) dans un délai de deux mois à compter :
- De la date à laquelle l’autorisation ou le certificat d’urbanisme contesté a été reçu en préfecture ou en sous-préfecture (CE, 6 juillet 2007, Cne de Saint-Paul-Trois-Châteaux, n°298744) ;
- Et/ou de la date de transmission du dernier acte (CE, 26 juillet 1991, Cne de Sainte-Marie de La Réunion, n°117717).
De plus, le préfet est tenu d’informer l’auteur de l’acte et le bénéficiaire de ce recours en annulation (art. R*600-1 du code de l’urbanisme (CU)). A défaut, la requête sera irrecevable.
Le préfet bénéficie d’une présomption d’intérêt pour agir contre les décisions qu’il défère.
Enfin, le préfet peut assortir sont déféré d’une demande de suspension (alinéa 3 de l’article L. 2131-6 du CGCT.
Dans sa demande de suspension sur déféré, le préfet dispose d’une position plus favorable que celle d’un requérant de droit commun. En effet, il n’a pas à établir une situation d’urgence à suspendre l’acte, la suspension sera accordée s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (art. L2131-6 CGCT et L554-1 code de justice administratif (ci-après CJA)).
Enfin, le juge statue dans un délai d’un mois sur la demande de suspension (CE, 22 avril 1988, n°78871).
Le déféré préfectoral peut être exercé d’office par le préfet mais il peut également être exercé à la demande d’un tiers lésé (2).
2. Le déféré préfectoral à la demande de la personne lésée
2.1. Régime applicable
La personne -physique ou morale, de droit public ou de droit privé- lésée par un acte administratif peut exercer un recours direct contre ce dernier devant le tribunal administratif compétent.
Mais, il peut également demander au préfet de déférer l’acte devant le tribunal administratif.
La personne lésée doit toutefois être vigilante quant au délai de recours contentieux de deux mois qui s’applique à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire (L2131-8 CGCT) et à son intérêt à agir. En outre, cette dernière doit avoir un intérêt à l’annulation de l’acte dans le cadre d’un recours direct (CE, 26 octobre 1984, n°49919).
De plus, la demande de déférer une décision d’urbanisme constitue un recours administratif (L600-3 CU) et doit être notifiée à l’auteur de l’acte et, le cas échéant, au titulaire de l’autorisation dans un délai de 15 jours (CE, 28 juillet 2000, n°211872).
Il est néanmoins utile de noter que le déféré préfectoral ne constitue pas une obligation pour le préfet et sa décision de ne pas déférer ou de déférer est discrétionnaire. S’il refuse de donner une suite favorable à la demande de déférer, sa décision ne peut être contestée (CE, sect., 25 janvier 1991, 80969).
Cela étant dit, bien que le préfet ne soit pas tenu de déférer devant le juge administratif toutes les décisions illégales des collectivités, la responsabilité de l’Etat peut être engagée dans un cas de figure : lorsqu’en refusant de déférer, le préfet commet une faute lourde (CE, 6 octobre 2020, n°205959).
2.2. Effets sur les délais de recours ouverts à la personne lésée
La demande présentée au préfet de déférer permet notamment de proroger le délai de recours contentieux.
Autrement dit, si la demande de déférer est formée dans le délai de recours contentieux de deux mois (pour contester par exemple une décision de refus de permis de construire) la demande a pour effet de proroger le délai jusqu’à ce que le préfet rende sa décision de déférer ou de ne pas déférer (CE, 19 janvier 1994, n°119275).
La demande de déférer au préfet doit être notifiée à l’auteur de la décision et, le cas échéant, au titulaire de l’autorisation sous peine de ne pas proroger le délai de recours contentieux (CE, 28 juillet 2000, 211872).
Point de vigilance : l’exercice du déféré préfectoral n’a pour sa part aucun effet sur le délai de recours contentieux de la personne lésée. Si le préfet change de d’avis en cours d’instance et ce désiste de son recours, la personne qui avait à l’origine sollicité le préfet pour qu’il défère un acte ne disposera pas de nouveau délai de recours (CAA Paris, 10 mars 1998, n°96PA02332).
Se reposer sur l’action préfectorale n’est donc pas sans risque.
Mirella RAKOTOVAO
Juriste
Ronan BLANQUET
Avocat
Maître Ronan Blanquet et son équipe se tiennent à votre disposition pour :
- Vous éclairez sur vos droits ;
- Sécuriser juridiquement vos projets et les faire aboutir ;
- Défendre vos intérêts en négociations ou au contentieux ;
- Agir dans les recours indemnitaires liés aux actions de l’administration.
cabinet@adicea-avocats.fr – 02.22.66.97.87.


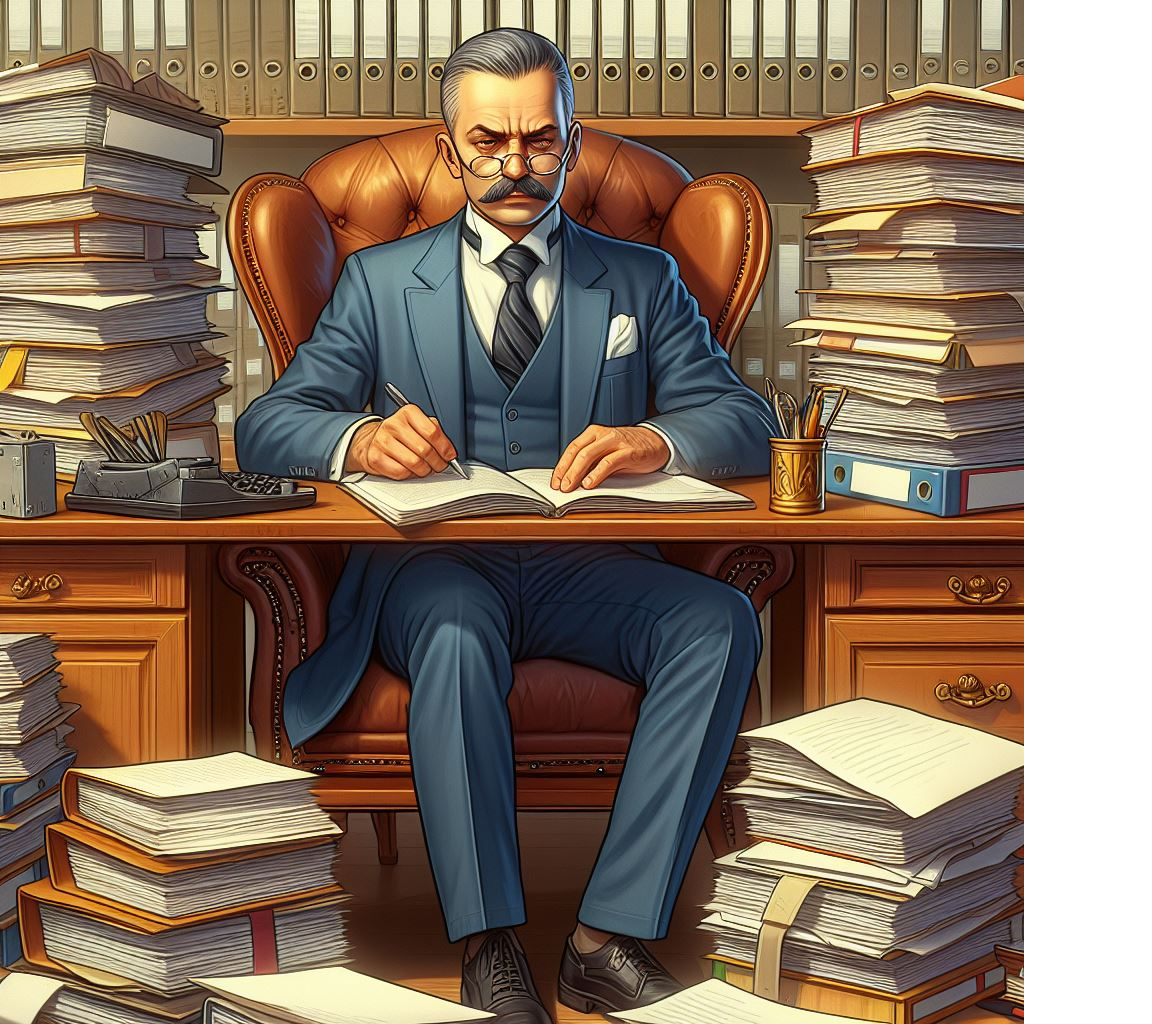
Pas de contribution, soyez le premier