L’ordonnance n° 2025-880 publiée le 4 septembre 2025 vient moderniser en profondeur les règles du crédit à la consommation en France. Elle vise à mieux protéger les emprunteurs, en tenant compte de l’évolution des offres de crédit, des habitudes des consommateurs et des pratiques numériques, tout en alignant le droit français sur les nouvelles règles européennes.
La réforme sera applicable à compter du 20 novembre 2026, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Les contrats conclus avant cette date continueront à être régis par la réglementation antérieure.
Objectifs de la réforme.
La réforme poursuit trois objectifs principaux :
- Renforcer la protection des consommateurs, dans un contexte d’évolution technologique rapide du crédit (digitalisation, microcrédits, paiement différé, etc.) ;
- Harmoniser davantage les règles au sein du marché unique européen, en limitant la diversité des régimes nationaux ;
- Lutter contre le surendettement, en encadrant les pratiques de distribution et les conditions de formation du contrat de crédit.
Une réforme à périmètre élargi : quels crédits sont désormais concernés ?
L’ordonnance élargit considérablement le champ d’application du droit du crédit à la consommation. Jusqu’ici, seuls les crédits compris entre 200 € et 75 000 € étaient encadrés par la législation spécifique. Désormais, sont également inclus :
- Les crédits gratuits (sans intérêt ni frais), dès lors qu’ils créent une charge de remboursement ;
- Les mini-crédits de moins de 200 € ;
- Les crédits de très courte durée (moins de 3 mois) avec des frais dits « négligeables » ;
- Les crédits entre 75 000 € et 100 000 € (notamment pour les biens de consommation haut de gamme) ;
- Les contrats de location avec option d’achat (LOA), très utilisés dans l’automobile et l’électroménager.
En France, certaines de ces pratiques (comme la LOA) étaient déjà encadrées, mais la directive impose une couverture complète, notamment via l’instauration d’un taux d’usure spécifique pour la LOA.
Un encadrement renforcé de la publicité et des pratiques commerciales.
La directive et l’ordonnance imposent de nouvelles limites à la publicité des crédits à la consommation. Certaines mentions seront interdites, notamment les suivantes :
- Indiquer que le crédit permettra une amélioration de la situation financière de l’emprunteur ;
- Mettre en avant des franchises de paiement supérieures à trois mois ;
- Présenter le crédit comme une solution immédiate sans contrepartie.
Ces pratiques sont déjà partiellement interdites en droit français, mais la réforme vient harmoniser et durcir les règles.
Informations et devoirs renforcés du prêteur.
1. Informations précontractuelles et contractuelles.
Les prêteurs devront désormais fournir des informations plus précises et adaptées au profil de l’emprunteur, avec une attention particulière pour :
- Les contrats de courte durée,
- Les crédits gratuits,
- Les micro-crédits.
La directive autorise une adaptation des exigences selon la complexité du contrat, mais impose un socle minimal d’informations.
2. Explications et devoir de conseil.
L’ordonnance consacre un devoir de mise en garde explicite du prêteur, qui doit :
- Fournir des explications adéquates sur les caractéristiques du crédit ;
- Informer clairement sur les risques d’endettement ;
- Orienter, le cas échéant, vers un service de conseil indépendant.
Analyse de solvabilité : des exigences accrues.
L’analyse de la capacité de remboursement devient un axe central de la réforme.
Elle doit s’appuyer sur :
- Des données vérifiables, y compris des justificatifs de revenus ;
- Un recours encadré aux outils automatisés (notamment l’intelligence artificielle), avec un devoir de transparence ;
- Une consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), sauf exceptions prévues pour les crédits de faible montant ou de courte durée.
Le but est de mieux anticiper les risques de défaillance et d’éviter la souscription impulsive.
Mesures pour les emprunteurs en difficulté.
L’ordonnance impose aux prêteurs de :
- Proposer des solutions de renégociation ou de rééchelonnement en cas de difficultés financières ;
- Orienter gratuitement les emprunteurs vers des services de conseil spécialisés en surendettement.
Ces obligations renforcent le rôle social du prêteur et s’alignent avec les dispositifs français déjà existants (Banque de France, commissions de surendettement).
Sanctions et encadrement renforcé des acteurs du crédit.
La réforme prévoit une refonte du régime des sanctions :
- Transformation de certaines sanctions pénales en sanctions administratives (plus souples et immédiates) ;
- Extension des obligations professionnelles (formation, compétence, secret professionnel) aux intermédiaires de crédit et gestionnaires de fichiers comme le FICP.
Les pratiques commerciales devront être strictement encadrées, y compris les ventes groupées (crédit + assurance), pour éviter toute pression sur le choix de l’emprunteur.
Calendrier d’application et transition.
Entrée en vigueur : 20 novembre 2026.
Les contrats signés avant cette date continueront à être régis par le droit antérieur.
Des dispositions transitoires sont prévues pour assurer une transition sans rupture du cadre juridique.
Conclusion : un tournant vers l’harmonisation maximale.
Cette réforme marque une rupture avec la directive de 2008, qui laissait aux États membres une plus grande liberté d’adaptation. Désormais, l’harmonisation est maximale, sauf exceptions prévues explicitement par la directive.
Pour les professionnels du crédit comme pour les juristes, cela implique :  Une mise à jour des pratiques contractuelles et des supports d’information,
Une mise à jour des pratiques contractuelles et des supports d’information,  Une vigilance accrue sur la conformité réglementaire,
Une vigilance accrue sur la conformité réglementaire,  Une formation renforcée du personnel au nouveau cadre légal.
Une formation renforcée du personnel au nouveau cadre légal.
La directive 2023/2225 impose un changement de paradigme : le crédit à la consommation devient un produit strictement encadré à l’échelle européenne, avec une exigence élevée de transparence, d’éthique et de responsabilité.


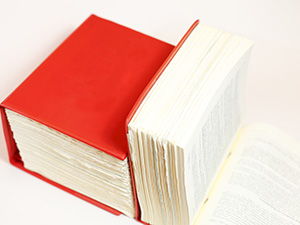
Pas de contribution, soyez le premier