Parmi les préjudices indemnisables après un accident de la route ou une erreur médicale, le préjudice sexuel occupe une place particulière. Il touche à l’intimité de la victime et à un aspect essentiel de la qualité de vie. Sa reconnaissance et son indemnisation répondent à une logique de réparation intégrale, telle que prévue par la jurisprudence et le référentiel des préjudices corporels.
Qu’est-ce que le préjudice sexuel ?
Le préjudice sexuel est défini comme l’ensemble des atteintes à la sphère sexuelle de la victime, qu’elles soient d’ordre physique, psychologique ou relationnel. Il comprend généralement trois dimensions :
1. Atteinte morphologique : déformations, mutilations ou séquelles physiques affectant l’apparence des organes génitaux ou l’image de soi.
2. Atteinte fonctionnelle : impossibilité ou difficulté à avoir des rapports sexuels (troubles de l’érection, absence de libido, douleurs lors des rapports, stérilité).
3. Atteinte relationnelle : conséquences sur la vie de couple, perte de chance de fonder une famille ou d’avoir des enfants.
Comment est-il évalué ?
L’évaluation du préjudice sexuel repose sur :
• Un examen médical spécialisé (urologue, gynécologue, sexologue, psychiatre si nécessaire).
• Un rapport d’expertise médicale qui décrit la nature et l’étendue de l’atteinte.
• L’analyse des conséquences concrètes sur la vie quotidienne de la victime (vie de couple, désir d’enfant, équilibre psychologique).
Le juge ou l’assureur se fonde sur ces éléments pour déterminer une indemnisation adaptée.
L’indemnisation du préjudice sexuel
Le préjudice sexuel fait partie des préjudices personnels permanents indemnisables après consolidation de l’état de santé. Son indemnisation est distincte du déficit fonctionnel permanent, même si les deux peuvent être liés.
Les sommes allouées varient selon :
• L’âge de la victime,
• La nature et la gravité des atteintes, • La perte de chance de réaliser un projet de vie familiale.
Il peut également être associé à d’autres postes de préjudice, comme le préjudice d’établissement (perte de la possibilité de fonder une famille) ou le préjudice moral.
La place du conjoint et des proches
Dans certains cas, le conjoint ou le partenaire peut également invoquer un préjudice d’accompagnement ou un préjudice sexuel indirect lorsqu’il subit lui-même les conséquences de l’atteinte sexuelle de la victime sur la vie de couple.
Conseils pour les victimes
• Ne pas hésiter à aborder cette question lors des examens médicaux et de l’expertise, même si elle est intime et délicate.
• Solliciter l’avis d’un médecin-conseil indépendant pour que l’atteinte soit correctement décrite dans le rapport.
• Être accompagné par un avocat qualifié pour défendre la reconnaissance et l’évaluation de ce préjudice devant l’assureur ou le tribunal.
Le préjudice sexuel, longtemps tabou, est aujourd’hui pleinement reconnu par les juridictions. Son indemnisation vise à restaurer, autant que possible, la dignité et la qualité de vie de la victime face à une atteinte invisible mais profondément destructrice.


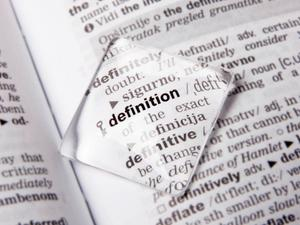
Pas de contribution, soyez le premier