L’URSSAF est à l’origine de près d’1 redressement judiciaire sur 4 : comment vous en défendre ?
⚠️ Près d'un redressement judiciaire sur quatre est déclenché par… l'URSSAF.
Une assignation en redressement judiciaire urssaf, et c'est tout un avenir qui bascule : tribunal, cessation des paiements, menaces de liquidation.
Pour beaucoup de dirigeants, c'est un choc brutal.
???? Pourtant, tout n'est pas perdu.
Le Code de commerce impose à l'URSSAF de rapporter la preuve de la cessation des paiements.
L'entreprise peut démontrer qu'elle dispose encore d'un actif disponible, de crédits ou de moratoires, ou encore présenter un plan de redressement crédible.
J'ai accompagné de nombreux chefs d'entreprise qui pensaient tout avoir perdu.
Certains ont réussi à convaincre le tribunal, à éviter la liquidation et à reprendre leur souffle.
???? Vous dirigez une société assignée par l'URSSAF ?
Chaque détail compte, chaque preuve peut faire la différence.
???? Je vous explique comment contester efficacement une assignation URSSAF et défendre votre entreprise :
Consultez Maître Eric ROCHEBLAVE par téléphone
Demandez à Maître Eric ROCHEBLAVE de vous défendre
Être assigné par l'URSSAF n'est pas un simple incident : c'est souvent le point de départ d'une procédure collective lourde de conséquences.
Redressements judiciaires, liquidations judiciaires ou sauvegardes…
Les statistiques montrent que l'URSSAF figure parmi les premiers déclencheurs de ces procédures.
Les chiffres sont parlants :
- Au 2e trimestre 2025 : « 22,4 % des entreprises en RJ et 16,3 % de celles en LJ au deuxième trimestre 2025 ont fait l'objet d'une assignation de l'Urssaf au cours des six mois précédents »[1]
- Au 1er trimestre 2025 : « 21,9 % des entreprises en RJ et 17,4 % de celles en LJ au premier trimestre 2025 ont fait l'objet d'une assignation de l'Urssaf au cours des six mois précédents »[2]
Autrement dit, près d'un redressement judiciaire sur quatre a pour origine une assignation de l'URSSAF.
Comprendre la notion de cessation des paiements
Avant toute ouverture d'une procédure collective, la première question posée par le juge est celle de la cessation des paiements.
Cette notion juridique, prévue par le Code de commerce, fixe les critères objectifs permettant de déterminer si une entreprise est en difficulté insurmontable ou si elle peut encore honorer ses engagements grâce à ses liquidités ou à ses soutiens financiers.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui « est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ».
Il résulte en outre de l'article R.631-2 du même code que « l'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Ces dispositions montrent que la cessation des paiements n'est pas une notion abstraite : elle repose sur des critères financiers précis et sur une charge de preuve clairement encadrée.
Qu’est-ce que l’état de cessation de paiements ?
La notion d'« état de cessation des paiements » est au cœur de toutes les procédures collectives.
Il se déduit de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est « en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible est composé en principe de toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. »[3]
Lorsque le « montant du passif exigible est supérieur au montant de l'actif disponible, l'entreprise est en état de cessation des paiements et relève par conséquent d'une procédure collective »[4].
« L'existence de résultats comptables bénéficiaires qui est le reflet d'une situation comptable au jour de la clôture des comptes, ne suffit pas à elle-seule à écarter une éventuelle situation de cessation des paiements à une date ultérieure, laquelle n'est pas une notion comptable déterminée sur la base des éléments statiques du bilan mais une notion de trésorerie résultant de la comparaison du passif exigible et de l'actif disponible à un moment donné. » [5].
Ainsi, la cessation des paiements ne dépend pas de la rentabilité apparente d'une entreprise ni de la présentation de ses comptes annuels.
C'est une notion de trésorerie, appréciée à un instant précis, qui compare dettes exigibles et liquidités disponibles.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par l’URSSAF qui demande l’ouverture de la procédure
Lorsqu'elle assigne une entreprise devant le tribunal de commerce, l'URSSAF ne peut se contenter d'affirmations générales.
Comme tout créancier demandeur, elle doit rapporter la preuve que la société se trouve réellement en état de cessation des paiements.
Cette exigence procédurale constitue un levier de défense majeur pour l'entreprise.
« La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure » [6]
En pratique, il revient donc à l'URSSAF de démontrer concrètement l'impossibilité pour l'entreprise de régler son passif exigible avec son actif disponible.
Si cette preuve est insuffisante ou lacunaire, la demande d'ouverture de procédure collective peut être rejetée.
C'est un argument de défense essentiel face aux assignations systématiques de l'organisme.
Qu’est-ce que l’actif disponible ?
Au cœur de la définition de la cessation des paiements se trouve une notion essentielle : l'actif disponible.
C'est ce critère qui permet au juge de mesurer si l'entreprise a encore les moyens immédiats de faire face à ses dettes exigibles.
Sa compréhension est donc déterminante pour toute défense contre une assignation de l'URSSAF.
« L'actif disponible est l'actif réalisable à bref délai. »[7]
« L'actif disponible s'entend de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement ou à très court terme (par exemple : Com. 2 nov. 2016, n° 14-18352). Il englobe notamment les sommes en caisse, les effets de commerce payables à vue, le solde créditeur des comptes bancaires, un chèque de banque (Com. 18 décembre 2007, n° 06-16350 - Com. 05 février 2013, n° 11-28194). »[8]
La démonstration d'un actif disponible suffisant — relevés bancaires positifs, liquidités immédiatement mobilisables, instruments de paiement garantis — peut faire basculer l'analyse du tribunal.
C'est un point clé pour prouver que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements et contrer efficacement une assignation initiée par l'URSSAF.
La preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur
Si l'URSSAF doit démontrer l'existence de la cessation des paiements, le débiteur n'est pas pour autant exempt de toute preuve.
Lorsqu'il invoque des facilités de trésorerie, comme des crédits disponibles ou des moratoires consentis par ses créanciers, c'est à lui qu'il appartient d'en apporter la justification.
« la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. » [9]
En pratique, il est donc essentiel pour l'entreprise de réunir tous les éléments bancaires, accords écrits ou attestations de créanciers prouvant ces soutiens financiers.
Ces documents peuvent suffire à convaincre le tribunal que, malgré les assignations de l'URSSAF, elle dispose encore des moyens nécessaires pour faire face à son passif immédiat.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la Cour statue
La procédure collective ne s'arrête pas au jugement de première instance.
Lorsqu'une entreprise interjette appel, la question essentielle de la cessation des paiements n'est plus figée : elle est réexaminée au regard de la situation financière actualisée au moment où la Cour statue.
« En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. » [10]
Cette règle ouvre une opportunité stratégique pour les entreprises : elles peuvent améliorer leur trésorerie, obtenir de nouveaux financements ou produire des éléments actualisés de nature à démontrer qu'elles ne sont plus en cessation des paiements.
L'appel devient alors un véritable levier de défense face à l'URSSAF.
???? A lire :
Changer d'avocat et choisir un avocat spécialiste
Votre « avocat en droit de la sécurité sociale » est-il un spécialiste ?
Quand une entreprise n’est-elle pas en cessation des paiements ?
La notion de cessation des paiements n'est pas automatique.
Elle suppose un déséquilibre réel entre dettes exigibles et liquidités disponibles.
Avant d'ouvrir une procédure collective, le tribunal doit vérifier si l'entreprise dispose encore des moyens financiers nécessaires pour honorer ses engagements immédiats.
Une entreprise n'est pas en cessation des paiements lorsque le montant du passif exigible n'excède pas le montant de l'actif disponible qui permet d'y faire face[11].
Ainsi, la démonstration d'une trésorerie suffisante ou de liquidités mobilisables à très court terme permet de repousser le constat de cessation des paiements.
C'est un argument central dans la défense des entreprises assignées par l'URSSAF, car il peut suffire à écarter l'ouverture d'une procédure collective.
Prouvez les perspectives de redressement de l’entreprise
Devant le tribunal, il ne suffit pas de nier l'état de cessation des paiements : il faut aussi convaincre de la viabilité de l'entreprise.
La juridiction n'ouvrira pas la porte à une simple déclaration d'intention.
Elle attend des preuves concrètes et chiffrées, capables de démontrer que l'activité peut se poursuivre et que les dettes pourront être honorées.
L'entreprise doit produire un « prévisionnel d'activité », des « explications et pièces sur les conditions dans lesquelles elle entend poursuivre son exploitation en générant un revenu lui permettant d'apurer son passif exigible et de payer ses charges nouvelles. » [12].
En pratique, plus le dossier présenté est solide, documenté et réaliste, plus les chances de convaincre le juge augmentent.
C'est un exercice délicat qui nécessite une préparation minutieuse : il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais d'un véritable plan de redressement argumenté.
L'assistance d'un avocat et, le cas échéant, d'un expert-comptable, est alors déterminante pour transformer un risque de liquidation en opportunité de sauvegarde.
Défendez-vous contre les assignations en redressement judiciaire de l’URSSAF !
Face aux assignations de l'URSSAF, chaque détail compte : définition de la cessation des paiements, preuve de l'actif disponible, existence de crédits ou moratoires, perspectives de redressement.
La défense repose sur une démonstration rigoureuse, appuyée par des pièces financières et juridiques solides.
Ne laissez pas l'URSSAF décider seule de l'avenir de votre entreprise.
???? En tant qu'avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale, je vous accompagne pour contester ces procédures, défendre vos intérêts et préserver vos chances de redressement.
???? Contactez-moi dès aujourd'hui pour préparer une stratégie adaptée à votre situation.
FAQ sur l’URSSAF et le redressement judiciaire
L’URSSAF peut-elle demander directement la liquidation judiciaire ?
Oui. Si elle considère que l'entreprise est en cessation des paiements sans perspectives de redressement, l'URSSAF peut assigner en liquidation judiciaire.
Quels arguments opposer à une assignation de l’URSSAF ?
Vous pouvez contester l'état de cessation des paiements, prouver un actif disponible suffisant, produire des moratoires ou crédits accordés, ou démontrer des perspectives crédibles de redressement.
Une entreprise bénéficiaire peut-elle être déclarée en cessation des paiements ?
Oui. Des résultats comptables positifs ne suffisent pas : la cessation des paiements est une question de trésorerie immédiate, pas de rentabilité comptable.
Qui supporte la charge de la preuve en cas d’assignation URSSAF ?
L'URSSAF doit prouver la cessation des paiements. Le débiteur, lui, doit prouver l'existence de réserves de crédit ou moratoires lui permettant d'honorer son passif exigible.
En combien de temps le tribunal statue-t-il après une assignation URSSAF ?
Très rapidement : la procédure collective étant d'ordre public, les audiences interviennent souvent dans les semaines suivant l'assignation.
Que se passe-t-il si l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de la cessation des paiements ?
Le tribunal peut rejeter la demande et refuser l'ouverture d'une procédure collective, ce qui constitue un succès important pour l'entreprise.
Est-il utile de se faire assister d’un avocat contre l’URSSAF ?
Oui. La défense repose sur une analyse juridique et financière fine. Un avocat spécialisé peut identifier les failles du dossier URSSAF, réunir les pièces et bâtir une argumentation solide.
[1] Baromètre économique URSSAF – juin 2025
https://www.urssaf.org/files/Statistiques/Nos%20études%20et%20analyses/Notre%20publication%20mensuelle/2025/Barometre_economique_178.pdf
[2] Baromètre économique URSSAF – mai 2025
/https://www.urssaf.org/files/Espace%20media/Communiqués%20de%20presse/CP210525/Barometre-economique-177.pdf
[3] Cour d'appel de Versailles, 2024-07-09, n° 24/00641
[4] Cour d'appel de Paris, 2025-07-11, n° 25/04940
[5] Cour d'appel de Paris, 2025-07-11, n° 25/04940
[6] Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2025, n° 25/00183
Cour d'appel de Versailles, 2024-07-09, n° 24/00641
[7] Cour d'appel de Versailles, 2025-07-15, n° 25/00093
[8] Cour d'appel de Versailles, 2024-07-09, n° 24/00641
[9] Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2025, n° 25/00183
Cour d'appel de Versailles, 2024-07-09, n° 24/00641
[10] Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2025, n° 25/00183
Cour d'appel de Versailles, 2025-07-15, n° 25/00093
[11] Cour d'appel de Paris, 2024-07-04, n° 24/01649
[12] Cour d'appel de Paris, 2025-07-11, n° 25/04940

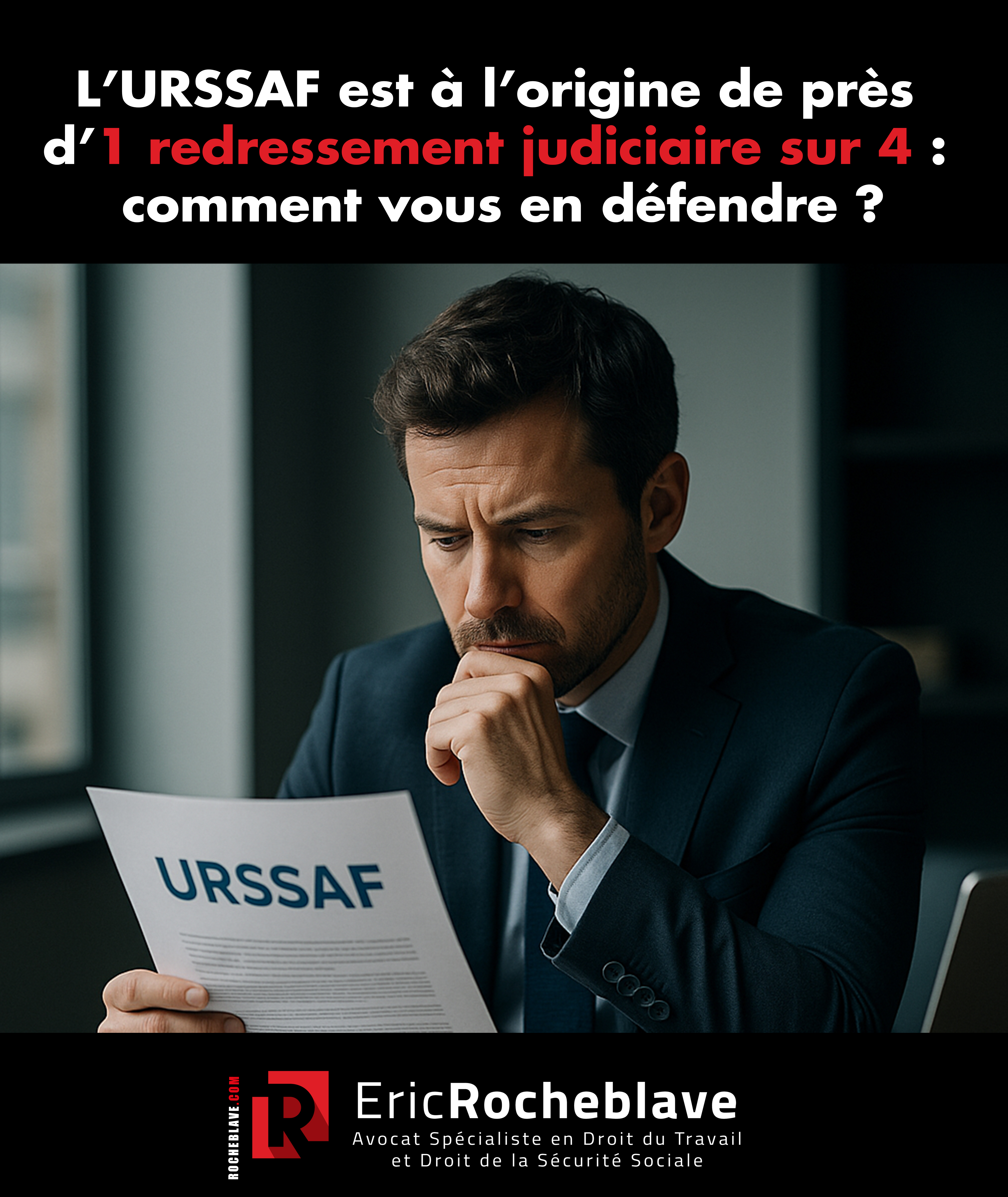
Pas de contribution, soyez le premier