Chronique critique d’une réforme qui réduit l’espace du justiciable
Il est des lois qui revendiquent la simplification avec l’assurance tranquille du progrès. Et puis il y a celles qui, sous couvert d’« efficacité », réorganisent silencieusement la scène contentieuse au profit de l’administration ou des opérateurs privés, en resserrant les marges de manœuvre du citoyen. La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement de 2025 appartient, incontestablement, à cette seconde catégorie.
Derrière les déclarations de modernisation, c’est une réorientation profonde du droit au recours qui se dessine. Et le praticien du contentieux de l’urbanisme ne peut manquer d’y lire une tendance nette : le rétrécissement programmé de l’accès au juge, savamment enveloppé dans le langage séduisant de la rationalisation.
I. Le recours gracieux : un ornement vidé de sa substance
La réforme opère ici un acte d’une redoutable finesse : le recours gracieux est maintenu, mais son utilité disparaît.
En ramenant son délai d’exercice à un mois, et surtout en supprimant l’effet traditionnel de prorogation du délai de recours contentieux, le législateur conserve l’apparence du dialogue avec l’administration tout en en retirant l’essentiel : la sécurité temporelle.
Le Conseil constitutionnel a validé la disposition, considérant qu’elle ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit au recours. Dont acte. Mais, dans la pratique, l’affaire est entendue :
-
le recours gracieux devient un piège procédural,
-
une manœuvre risquée pour le requérant non averti,
-
un leurre pour celui qui croit encore aux vertus de la négociation préalable.
Dorénavant, le justiciable de bonne foi, qui tente un apaisement, risque simplement… de se retrouver forclos, sans voie contentieuse. La conciliation est louée dans le discours, mais sanctionnée dans les faits.
II. La cristallisation des règles d’urbanisme : sécurité juridique pour les uns, verrouillage pour les autres
La réforme consacre la cristallisation des règles d’urbanisme applicables aux permis modificatifs. Une vieille revendication des aménageurs : disposer d’un cadre stable, même lorsque le PLU évolue.
Pour les pétitionnaires, l’avancée est réelle. Pour les tiers contestataires, l’équation change :
-
le permis modificatif devient moins vulnérable,
-
les évolutions défavorables du PLU deviennent indifférentes,
-
l’atteinte aux documents d’urbanisme est mécaniquement moins contestable.
Le Conseil constitutionnel valide, mais la philosophie est limpide : le droit de l’urbanisme n’est plus pensé comme un équilibre entre l’intérêt privé du constructeur et l’intérêt général porté par les documents d’aménagement. Il devient un instrument d’optimisation du projet.
III. La disparition de l’article L. 600-1 : un recul discret mais majeur
La suppression de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme entraîne un effet immédiat : l’impossibilité, dans la plupart des cas, d’invoquer par voie d’exception l’irrégularité d’un document d’urbanisme hors délai.
Autrement dit, le requérant qui n’a pas attaqué le PLU dans les deux mois suivant son approbation se voit désormais définitivement privé de la possibilité d’en soulever la légalité dans une procédure ultérieure.
Cette extinction accélérée des moyens tirés des vices de forme et de procédure constitue une restriction substantielle du contrôle juridictionnel de la planification urbaine. C’est une réforme moins visible, mais structurante : elle referme progressivement la porte de l’exception d’illégalité, jusque-là l’outil le plus souple et le plus protecteur pour le justiciable tardivement affecté par une règle nouvelle.
IV. La tentative (avortée) de conditionner l’intérêt à agir : un signal politique
La censure par le Conseil constitutionnel de l’obligation de participation du public pour avoir intérêt à agir contre un document d’urbanisme n’efface pas l’intention.
Exiger du requérant qu’il ait pris part à l’enquête publique ou à la mise à disposition pour être recevable à contester l’acte traduisait une idée simple : réduire le nombre de requérants en imposant un filtre procédural supplémentaire.
La censure constitutionnelle rappelle utilement que l’accès au juge n’est pas une faveur administrative. Mais l’intention politique demeure : reserrer l’espace contentieux, disqualifier le tiers contestataire, renforcer la position de celui qui construit.
V. Le référé-suspension facilité… mais uniquement contre les refus
La nouveauté est trompeuse : le législateur instaure une présomption d’urgence en référé-suspension uniquement pour les refus d’autorisation d’urbanisme. Le pétitionnaire est donc placé dans une position plus favorable que celle du voisin qui souhaite suspendre un permis de construire contesté.
Il y a là, de nouveau, un déséquilibre assumé :
-
lorsque l’administration dit non, le requérant peut aller vite,
-
lorsqu’elle dit oui, le tiers doit démontrer l’urgence, souvent difficile, parfois impossible.
VI. Une philosophie d’ensemble : accélérer les projets, ralentir le contrôle
L’esprit de la réforme est clair :
Dans le doute, faire pencher la balance vers la réalisation du projet plutôt que vers l’examen du recours.
Le contentieux de l’urbanisme devient moins un instrument de régulation et davantage un obstacle à neutraliser. Le justiciable est invité à la célérité, à la vigilance absolue, voire à la défiance. La logique protectrice du droit au recours s’efface derrière une volonté d’efficience administrative.
La « simplification » n’est que l’autre nom d’une procéduralisation plus stricte, où l’erreur se paye cash et où le droit à l’erreur disparaît.
Conclusion : une réforme douce en surface, dure en profondeur
Cette loi ne supprime pas le recours contentieux. Elle ne le restreint même pas frontalement. Elle fait simplement mieux : elle rend l’exercice du recours plus fragile, plus dangereux, plus incertain.
Le recours gracieux devient un piège. L’exception d’illégalité s’évanouit. Le permis modificatif se blinde. La participation du public devait devenir obligatoire. Le référé-suspension devient asymétrique.
Le tout compose un paysage où le droit de contester recule sans que nul ne puisse dire qu’il a été supprimé. C’est là tout l’art des réformes habiles : elles modifient peu de mots, mais transforment profondément les trajectoires contentieuses.
Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en Droit de l’environnement, Bureau de Grasse : 48 Avenue Pierre Sémard, 06130 GRASSE et bureau de Paris : 222 Bd Bd Saint Germain, 75007 PARIS. Tel : 01 42 60 04 31 (Paris) ou 04 93 69 36 85 - Le Cannet et Grasse.

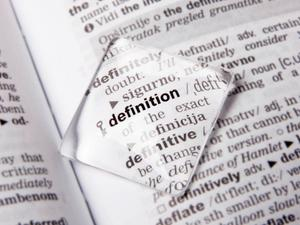
Pas de contribution, soyez le premier