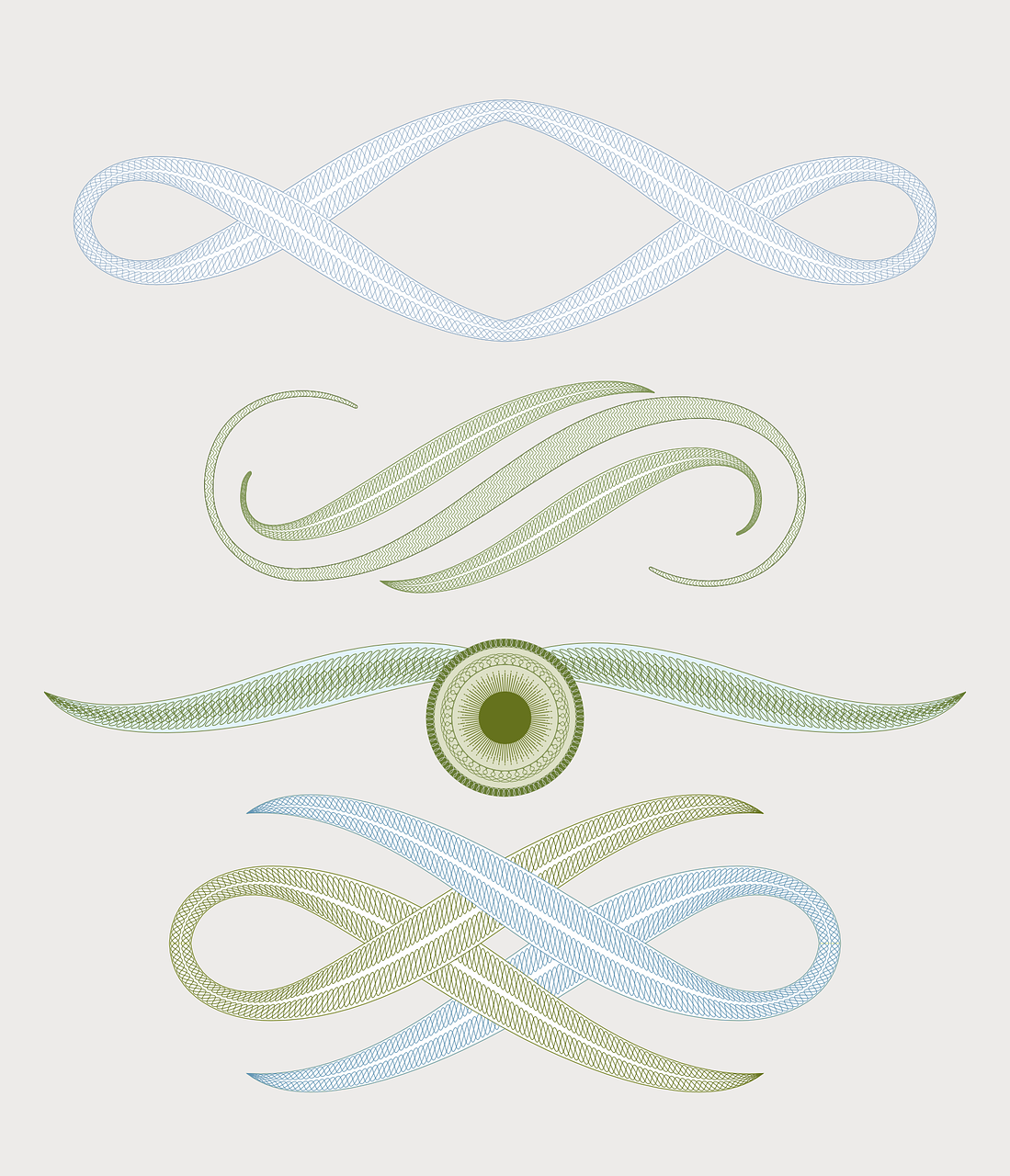Les graphistes et designers sont titulaires de droit d’auteur sur les logos ou identités visuelles qu’ils créent dans le cadre de contrats de commande. Cela implique que le commanditaire se fasse céder les droits d’exploitations sur le logo pour pouvoir l’exploiter pleinement et sereinement. En contrepartie le graphiste pourra recevoir une rémunération correspondante.
A l’occasion d’un dossier récent, j’ai pu remarquer que dans un cadre précontentieux ou contentieux entre un graphiste auteur d’un logo et l’entreprise commanditaire des logos, trois questions de droit d’auteur étaient régulièrement soulevées :
- Le logotype créé dans le cadre d’un contrat de commande par un graphiste est-il original, et dès lors, protégé par le droit d’auteur ?
- Qui est titulaire du droit d’auteur et peut-on considérer qu’il s’agit d’une œuvre collective ?
- La cession de droit d’auteur au bénéfice du commanditaire existe-t-elle et si oui quel est son périmètre ?
Je propose dans cet article d’examiner ces trois points à l’aide de quelques décisions de jurisprudence. En gras, je vous propose des conseils pour prévoir les situations en amont et éviter les difficultés auxquelles vous pourriez être confrontés.
1 – La protection par le droit d’auteur des logotypes sous condition d’originalité
Devant le tribunal, le commanditaire d’un logotype sera souvent tenté de prétendre que le logotype est dénué d’originalité et dès lors, n’est pas protégé par le droit d’auteur. Cela lui permettra d’exploiter librement le logo alors qu’il n’a pas pris la précaution de se faire céder les droits en amont et ainsi d’éviter d’être condamné pour contrefaçon.
En effet, il faut rappeler que les logotypes, comme toutes les œuvres de l’esprit, sont protégeables par le droit d’auteur, dès lors qu’ils sont originaux, c’est-à-dire revêtus de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Cette protection naît sans aucune formalité. Concrètement, l’originalité s’apprécie au cas par cas, c’est-à-dire logo par logo en fonction des choix créatifs.
Il faut rappeler que depuis une dizaine d’années, lorsque l’une des parties au procès conteste la protection par le droit d’auteur d’une œuvre de l’esprit, c’est à l’auteur ou à celui qui se prévaut de la protection de démontrer l’originalité[1]. De plus, l’appréciation de l’originalité relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation ne faisant que vérifier que les juges du fond l’ont caractérisé.
S’agissant d’un logo, « L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier (…) confère (à l’œuvre) une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. » (TGI Paris 12 janvier 2017, Mycellium Roulement c/ Todo Material 3M et autres).
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 10 mars 2017 a par exemple pu considérer qu’un nom de parfum (SoOud) et un logo étaient originaux en considérant que la combinaison des deux mots en un seul était singulière, et s’agissant du logo que le « dessin de deux courbes qui se rejoignent et se croisent laissant apparaître la figure d’un œil encerclé par des parenthèses jouxtant les extrémités des courbes (…) est singulier et reflète la personnalité de l’auteur » (CA Paris 10 mars 2017 n°15/09974).
En amont, il est préférable de considérer que le logo commandé est original et de prévoir une cession de droit d’auteur pour l’exploitation du logo. Cette cession fera l’objet d’une rémunération.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est établie, il convient de s’interroger sur la titularité des droits.
2 – Qui est titulaire du droit d’auteur et peut-on considérer que le logo est une œuvre collective ?
En principe, le titulaire des droits d’auteur est toujours la personne qui a effectivement créé l’œuvre.
L’enjeu de la qualification d’œuvre collective dans les contentieux portant sur les droits d’auteur sur un logo est de faire naître le droit d’auteur sur la tête de l’entreprise commanditaire du logo et non sur la tête du graphiste, auteur personne physique. Cela évite ainsi de procéder à une cession de droits et de devoir payer des droits d’auteur pour le commanditaire.
L’article L 113-2 alinéa 3 du CPI définit l’œuvre collective comme « l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
Pour qu’une œuvre soit collective, il faut la réunion de plusieurs conditions et notamment :
- qu’il y ait plusieurs auteurs.
- que les directives de création soient données par le commanditaire de façon très précise, privant ainsi le graphiste de sa liberté de création.
Or, ces deux conditions sont rarement remplies dans le cadre de la création de logo.
Par exemple, la Cour d’appel de Paris (24 mars 2017, n°16/10690) a écarté l’œuvre collective en soulignant d’une part, qu’en l’espèce il n’y avait qu’une seule graphiste qui avait créé le logo et d’autre part que si les commanditaires ont posé des exigences telles que l’intégration du nom commercial « créateur de plaisir », l’utilisation d’une police d’écriture sobre ou l’utilisation de certaines couleurs, « cette commande ne s’inscrivait pas dans une situation de subordination ou de direction ». Ainsi, le fait qu’il n’y ait qu’une seule graphiste et qu’elle ait fait de nombreux choix seule exclut nécessairement la qualification d’œuvre collective.
3 – L’existence d’une cession de droits au bénéfice du commanditaire et le cas échéant son périmètre
L’article L 111-1 du CPI précise que le contrat de commande n’emporte pas cession des droits au bénéfice du commanditaire. Autrement dit, la commande d’un logo ne permet pas au commanditaire de l’exploiter librement.
Il faut que le graphiste, ou la société par l’intermédiaire de laquelle il exerce son activité, cède ses droits sur le logo. En principe, la cession s’organise par le biais d’un contrat de cession de droits conforme aux prescriptions de l’article L 131-3 du CPI[2] selon laquelle chacun des droits cédés doit faire « l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
Dans la pratique, deux situations se rencontrent :
- il n’y a aucun écrit, se pose alors la question de savoir si il y a eu une cession de droits implicite ;
- il y a une cession dans le devis ou dans la facture qui précise souvent le territoire, la durée et les usages autorisés. Toutefois, comme la cession est peu détaillée, elle peut apparaître équivoque ou peu claire.
- L’absence de cession écrite
L’exigence d’un écrit en matière de cession de droit d’auteur sert à prouver l’existence de la cession. Autrement dit, l’absence d’écrit ne signifie pas nécessairement l’absence de cession de droits. D’autres éléments (des mails par exemple) pourront permettre de démontrer la cession si il n’y a pas de contrat.
Lorsqu’il n’y a pas du tout de cession écrite dans la relation entre un auteur et un commanditaire qui va exploiter une œuvre, telle que le logo par exemple, la question de savoir si le commanditaire peut exploiter le logo va se poser.
Des arrêts des années 2000 ont admis la cession implicite en matière de logos. Ainsi la Cour d’appel de Paris a pu juger en 2006[3] que : « C’est à juste titre que le Tribunal qui a relevé qu’aucun écrit ne précisait la mention d’une cession de droits, a néanmoins retenu qu’il résultait de la nature des prestations réalisées par la société KAP ! (logo, charte graphique et magazine) que le paiement des prestations contenait nécessairement cession des droits de propriété intellectuelle ; qu’en effet, ces réalisations acceptées par la société WBC signifiaient que celle-ci pouvait les utiliser à l’avenir au moins dans les formes prévues. »
Il ressort de cet arrêt que la jurisprudence admet des cessions implicites y compris lorsque l’une des parties au contrat de commande est un auteur personne physique.
Toutefois, dans un arrêt plus récent, la Cour de cassation (26 septembre 2019, n°17-19997) considère qu’il n’y a pas de cession implicite lorsqu’un designer créé toute une ligne de produits et sait que ces produits sont exploités pendant plusieurs années, au motif qu’il « n’a cessé de contester les conditions d’exploitation de ses œuvres et avait écrit le 25 novembre 2011 à M. X… pour souligner que ses travaux de création demeuraient aujourd’hui encore sans contrepartie financière et pour réclamer l’établissement d’un contrat ». Le commanditaire n’ayant opposé aucune dénégation[4].
Il semble donc qu’il y ait un durcissement de la jurisprudence qui recherche désormais la volonté du graphiste de céder les droits sur son logo, et ne considère pas que la cession de droits s’infère du paiement des prestations liées au temps de travail.
Il est vivement conseillé de toujours prévoir une cession de droit expresse. A défaut, il y a une incertitude particulièrement forte sur les possibilités d’exploiter le logo pour le commanditaire. Le graphiste pourra négocier la rémunération correspondant aux modes d’exploitation prévus dans le contrat.
- L’existence d’une cession de droits dont les limites sont équivoques
Lorsqu’il y a une cession de droits, elle est parfois équivoque, et le contentieux se concentre alors sur l’étendue de la cession. Dans ce cas, le juge recherche la commune intention des parties pour déterminer l’étendue de la cession de droits.
Par exemple, la Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 24 mars 2017 (n°16/10690) a pu considérer que la cession de droits sur le logo avait été consentie à une boulangerie pâtisserie, mais pas aux trois autres boulangeries ouvertes par la suite et exploitées par des personnes morales distinctes. Ainsi, l’exploitation faite par ces trois nouvelles boulangeries constituaient des contrefaçons.
Pour éviter toute difficulté, il est conseillé de passer un contrat exprès de cession de droit obéissant aux prescriptions de l’article L 131-3 du CPI et, pour le commanditaire, de prévoir toutes les exploitations envisagées et, pour le graphiste (ou sa société) de prévoir les rémunérations associées aux différentes exploitations demandées par le commanditaire.
Maître Blandine CORNEVIN
[1] En effet, la jurisprudence s’est largement durcie sur ce point. Il faut d’ailleurs noter qu’une mission du CSPLA est en cours pour examiner la possibilité de simplifier la preuve de l’originalité, éventuellement en posant des présomptions.
[2] Il faut préciser que l’article L 131-3 du CPI ne s’applique, à strictement parler, que dans les relations avec l’auteur personne physique et non entre les sociétés exploitant l’œuvre. Il est toutefois recommandé de toujours passer des contrats en respectant les prescriptions de l’article L 131-3 du CPI.
[3] CA Paris 4ème chambre, section B, 12 mai 2006, n°05/12886
[4] Il est à souligner que la cour d’appel de paris avait précisé dans l’arrêt ayant fait l’objet du pourvoi qu’une cession ne pouvait être implicite (CA Paris, 10 mars 2017, n°15/09974).