Parmi les nombreuses définitions de l’Académie française, l’édition est « un ensemble des opérations relatives au choix, à l’impression, à la publication d’un ouvrage littéraire, scientifique, artistiques, etc ». Elle est également un « établissement rigoureux du texte d’une œuvre, en vue d’une publication ».
En France, selon le Syndicat national des éditeurs (SNE), il y a environ 10 000 éditeurs, « cette densité est voisine de celle de nombreux pays d’Europe » [1].
Dans son rapport statistique les chiffres de l’édition 2019-2020 [2], le SNE a classé 13 secteurs par chiffre d’affaires [3]. Toutefois, dans le dernier rapport les chiffres de l’édition 2024-2025, le SNE soulève une baisse des ventes concernant l’ensemble des segments éditoriaux à l’exception notable de la littérature, "compte tenu du dynamisme de la romance" [4].
L’objet de cet article est donc de présenter la spécificité du contrat d’édition dans le domaine littéraire.
1- La nécessité d’un contrat d’édition.
Conformément à l’article L132-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) :
« le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée l’éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».
L’auteur doit être vigilant sur l’existence de deux types de contrats, qui ne sont pas des contrats d’édition.
À savoir :
- Le contrat dit à compte d’auteur : par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique et d’en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par les articles 1787 et suivants du Code civil. Et il n’y a pas de cession de droit d’auteur sur l’œuvre dans ce type de contrat [5].
- Le contrat dit de compte à demi : par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une société en participation régi par les articles 1871 et suivants du Code civil, il n’y a pas de cession de droit d’auteur sur l’œuvre [6].
1.1. L’exigence d’un contrat d’édition écrit et les principales clauses à insérer.
Au vu des dispositions de l’article L132-1 du CPI, le contrat d’édition doit être rédigé par écrit, qui est une condition de validité de la cession des droits.
Le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire [7].
Depuis le 12 novembre 2014, le contrat d’édition doit prévoir deux parties distinctes, une partie relative aux droits d’exploitation numérique de l’œuvre et une seconde partie relative aux droits imprimé de l’œuvre, à peine de nullité de la cession des droits [8].
L’auteur doit s’assurer de l’insertion de certaines clauses dans le contrat d’édition, à savoir sur :
- La cession de droit d’auteur : chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, et le domaine d’exploitation des droits cédés doit être limité quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée de l’exploitation [9].
- La rémunération proportionnelle de l’auteur [10] : c’est-à-dire, selon un pourcentage pris sur la base du prix public hors taxe du livre et le nombre d’exemplaires vendus. Le paiement doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêté des comptes. Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l’auteur dispose d’un délai de douze mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder. Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit [11].
- L’à-valoir versé par l’éditeur : il s’agit d’une avance sur les droits d’auteur futurs que l’auteur percevra en fonction des ventes de l’ouvrage. Son versement marque l’engagement de l’éditeur envers l’auteur et valorise le travail de création. Son montant est un élément clé de la négociation contractuelle.
- La durée du contrat : Il faut éviter la conclusion de contrats perpétuels prohibés par l’article 1210 du Code civil et protéger ainsi, la liberté contractuelle de l’auteur, qui ne peut être indéfiniment lié à un éditeur.
- Le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage que devra publier l’éditeur [12],
- Et les obligations réciproques des parties, et notamment celle de l’éditeur [13].
1.2. Les obligations réciproques de l’auteur et de l’éditeur.
Parmi les principales obligations de l’auteur, ce dernier doit :
- Garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé [14].
- S’interdire de commettre toute contrefaçon,
- Remettre à l’éditeur dans le délai prévu au contrat, l’œuvre [15],
- Mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre [16].
Quant à l’éditeur, ses obligations contractuelles sont énoncées aux articles L132-11 à L132-14 du Code de la propriété intellectuelle :
- L’obligation de publier l’œuvre : qui est une obligation de résultat pour toutes les formes d’exploitation prévues au contrat, aussi bien imprimée que numérique.
- L’obligation de n’apporter à l’œuvre aucune modification sans autorisation écrite de l’auteur.
- Sauf convention spéciale, l’obligation de publier dans un délai fixé par les usages de la profession. Qui est de 18 mois maximum à compter de la remise du manuscrit pour la version imprimée et de 15 mois à compter de la remise du manuscrit pour la version numérique.
- L’obligation de respecter le droit de paternité de l’auteur.
- L’obligation de rendre compte et de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.
- Rémunérer l’auteur.
- L’obligation d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie, et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession : il s’agit d’une obligation de résultat, définie de manière précise à l’article 4 de l’accord interprofessionnel du 1ᵉʳ décembre 2014 sur le contrat d’édition dans le secteur du livre.
En effet, à l’article 4.1 dudit accord, pour une édition imprimée, l’obligation d’exploitation permanente et suivie est caractérisée par la réunion des critères suivants :
- Présenter l’ouvrage sur ses catalogues papier et numérique ;
- Présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles répertoriant les œuvres disponibles commercialement ;
- Rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l’œuvre et conforme aux règles de l’art quel que soit le circuit de diffusion ;
- Satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage.
À l’article 4.2, pour une édition sous forme numérique, l’obligation d’exploitation permanente et suivie, est caractérisée quant à elle par les critères suivants :
- Exploiter l’œuvre dans sa totalité sous une forme numérique ;
- La présenter à son catalogue numérique ;
- La rendre accessible dans un format technique exploitable ;
- La rendre accessible à la vente.
Cette obligation de résultat est fréquemment rappelée par la jurisprudence. Récemment, il a été jugé que l’éditeur ne pouvait s’affranchir d’une telle obligation en invoquant « le mauvais accueil de la critique des libraires ou du public » [17].
Aussi, les juges ont rappelé que l’obligation d’exploitation permanente et suivie implique « un effort réel et continu de promotion de l’œuvre, conformément aux usages professionnels » et « l’éditeur ne doit pas simplement se contenter de rendre un ouvrage disponible dans des catalogues ou sur commande » [18].
Un tel manquement est sanctionné par la résiliation aux torts exclusifs de l’éditeur, suivi de dédommagement de l’auteur lésé.
2- Cas jurisprudentiel spécifique : la demande d’annulation d’un contrat pour dol.
Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 juin 2024, plusieurs auteurs ont signé des contrats intitulés « contrat de publication d’œuvre littéraire » avec une maison d’édition, pensant avoir signé un contrat d’édition, qui était, en fait un contrat de compte à demi. Ils saisissent la cour d’appel, à titre principal, en vue d’annuler les contrats, en invoquant des manœuvres dolosives de l’éditeur, et à titre subsidiaire, ils sollicitent la résiliation [19].
Les contrats prévoyaient « la prise en charge par l’auteur d’une partie du coût total de l’édition à hauteur de 4 000 € en espèce ».
Selon les auteurs, et conformément à l’article 1116 du Code civil, leur consentement était vicié, par plusieurs manœuvres dolosives, notamment sur la qualité de « l’éditeur », qui était anciennement une entreprise de pneumatiques dépourvue d’expérience dans l’édition, et dont le dirigeant a été condamné pour escroquerie, et sur la qualité hybride et confuse du contrat signé.
La cour a déduit que « la condamnation réelle ou supposée du dirigeant pour escroquerie dans une affaire totalement étrangère à celle dont est saisie la cour est indifférente comme le changement d’objet social de la société ». Ainsi, selon la cour, « aucun mensonge ni manœuvres de la société éditrice sans lesquels les auteurs n’auraient pas contracté ne sont établis par les appelants et leurs demandes tendant à la nullité des contrats pour vice du consentement doivent être rejetée ».
Les auteurs doivent être vigilants avant chaque signature d’un contrat en vue de la publication d’un livre. En effet, lorsqu’il est demandé à l’auteur de verser une quelconque somme d’argent, il doit garder à l’esprit, qu’il n’est pas en présence d’un contrat d’édition.
Avant toute action en justice, il est indispensable de se constituer des preuves solides à l’appui de ses prétentions, sous peine de voir ses demandes rejetées et de se voir condamné à l’article 700 du Code de procédure civile.
3- Les obligations essentielles d’un éditeur et résiliation du contrat d’édition pour manquement à ses obligations contractuelles.
Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2024 illustre l’importance pour un éditeur d’appliquer avec loyauté les termes du contrat d’édition et que tout manquement peut être sanctionné par la résiliation pure et simple du contrat, suivie de dédommagement de l’auteur lésé.
Dans cette décision (TJ Paris, 15 nov. 2024, n° 24/07500), une autrice a conclu un contrat d’édition portant cession de ses droits d’auteur sur les illustrations d’un livre pour enfant. Il était convenu une rémunération proportionnelle calculée sur le prix public hors taxes et un à-valoir sur celle-ci de 880 euros, payable pour moitié à la signature du contrat et moitié à la remise des œuvres.
Après la remise des illustrations et en dépit de nombreuses relances et d’une mise en demeure, l’à-valoir n’a pas été payé. L’autrice a ensuite mis en demeure l’éditeur de régler les sommes dues, de justifier du nombre d’exemplaires imprimés et retirer l’ouvrage des catalogues et de la vente.
Elle l’a ensuite assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon, en résiliation du contrat d’édition et en réparation des préjudices afférents.
S’agissant des actes de contrefaçons, elle indique que l’éditeur a publié l’ouvrage litigieux sans procéder au paiement de l’à-valoir, sans obtenir son accord et son bon-à-tirer prévus au contrat, et sous un nom mal orthographié.
Sur les manquements contractuels, les juges ont estimé qu’au vu des pièces produites par la demanderesse, cette dernière est fondée à solliciter la résiliation du contrat d’édition compte tenu des violations contractuelles de l’éditeur.
Toutefois, au sujet de sa demande de contrefaçon, si son œuvre est protégée par le droit d’auteur, la diffusion de l’ouvrage a été effectuée dans le cadre du contrat d’édition de sorte que, selon les juges, elle ne constitue pas une contrefaçon. En effet, la demanderesse ne peut à la fois solliciter l’exécution forcée du contrat d’édition, en sollicitant le paiement complet de l’à-valoir et l’approbation par « bon-à-tirer » et soutenir des faits de contrefaçons de droit d’auteur.
Mais selon les juges, la contrefaçon n’a pu intervenir qu’après la mise en demeure en invoquant la résiliation du contrat.
Ainsi, les juges ont prononcé la résiliation du contrat d’édition et ont condamné l’éditeur à régler à l’autrice, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements contractuels, 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon des illustrations originales du livre litigieux et 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conclusion, les auteurs doivent prendre soin avant de signer un contrat de bien vérifier chaque clause et de ne pas hésiter à négocier les termes du contrat. En cas de manquements contractuels, l’auteur doit se constituer des preuves tangibles. Et avant d’adresser une mise en demeure en vue d’une résiliation, il est recommandé à l’auteur de respecter les délais légaux. Quant aux éditeurs, ils ne doivent pas se contenter d’inclure des clauses dans un contrat d’édition sans respecter les termes. Ils doivent bien au contraire, déployer de manière concrète et réelle tous les efforts pour assurer l’édition et la promotion de l’œuvre d’un auteur.
Dalila MADJID, Avocate
Notes de l'article:
[1] https://www.sne.fr/faq-de-ledition/
[2] https://www.sne.fr/app/uploads/2020/10/RS20_Synthese_web.pdf
[3] 1- Littérature : avec un chiffre d’affaires de 571,8 M€
2- Scolaire : 387,8 M€ en forte hausse grâce à la réforme du Baccalauréat et de la voie professionnelle.
3- Sciences humaines et sociales : 380,5 M€, augmentation des ventes portée principalement par l’édition juridique
4- Jeunesse : 351,2 M€
5- Livres pratiques : 340,7 M€
6- Bande dessinée, comics, manges : 307,3 M€
7- Documents, actualités, essais : 102,4 M€
8- Art et beaux livres : 69,2 M€
9- Sciences : 67,6 M€
10- Religion et ésotérisme : 41,5 M€
11- Dictionnaires et encyclopédies : 25,9 M€
12- Cartes géographiques et atlas : 16,9 M€
13- Ouvrages de documentation : 1,74 M€.
[4] https://www.sne.fr/actu/les-chiffres-de-ledition-en-2024-baisse-en-valeur-et-en-volume-du-chiffre-daffaires/
[5] CPI art. L132-2.
[6] CPI art. L132-3.
[7] CPI art. L132-7.
[8] CPI art. L132-17-1.
[9] CPI art. L131-3.
[10] CPI L132-5.
[11] CPI art. L132-17-3-1.
[12] CPI art. L132-10.
[13] CPI art. L132-1 à L132-17.
[14] CPI art. L132-8.
[15] CPI art. L132-9.
[16] CPI art. L132-9.
[17] CA Rennes, 16 sept. 2022 n°19/03935.
[18] CA Aix-en-Provence 26 mars 2025 n°20/13029.
[19] CA Paris, 21 juin 2024, n° 22/20801.

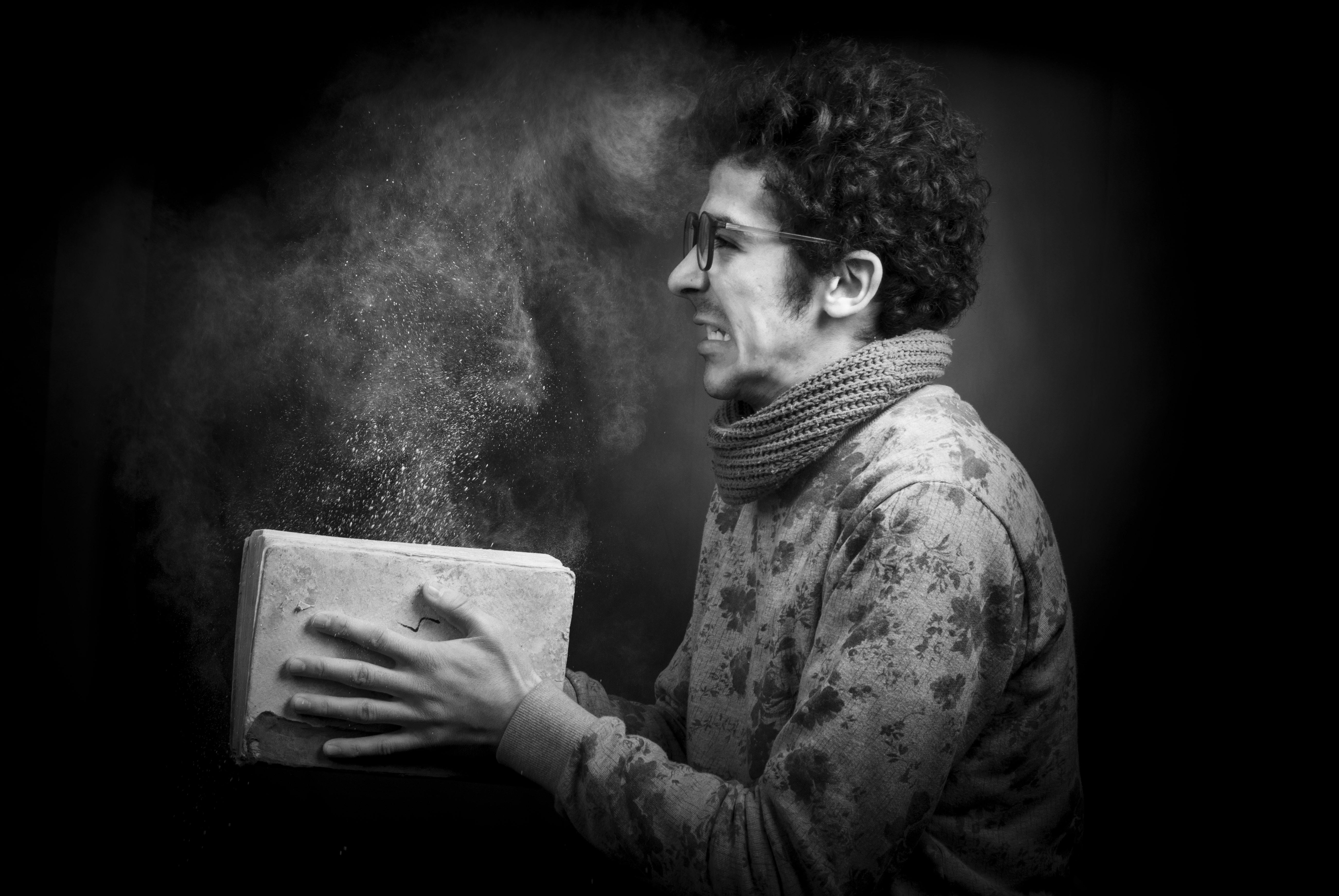
Pas de contribution, soyez le premier