1. Introduction : une obligation à géométrie variable
L’article L.225-129-6 du Code de commerce impose, en principe, à toute assemblée générale extraordinaire (AGE) appelée à décider d’une augmentation de capital en numéraire, de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réserver une part de cette opération aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE). Cette exigence répond à une volonté du législateur d’associer les salariés à la croissance du capital social, dans un esprit de démocratie actionnariale.
Mais cette obligation connaît plusieurs tempéraments, notamment lorsque l’opération envisagée repose sur l’émission de valeurs mobilières complexes (VMC). C’est précisément cette hypothèse qui suscite, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, des interrogations récurrentes en pratique.
Faut-il systématiquement soumettre à l’ordre du jour une résolution PEE lorsqu’est proposée l’émission d’obligations convertibles, d’actions assorties de bons, ou encore de BSA ? Tout dépend, comme le montrent les analyses croisées de l’ANSA, de la CNCC et de la doctrine, de la nature du titre primaire et de l’effet dilutif immédiat ou différé de l’opération.
2. Trois catégories de VMC : une typologie déterminante
Le critère décisif pour déterminer l’existence ou non de l’obligation visée à l’article L.225-129-6 repose sur la combinaison de deux facteurs :
-
La nature du titre primaire émis (action ou obligation),
-
Le moment de la dilution (immédiate ou à terme).
On distingue ainsi trois catégories principales de VMC :
2.1. Valeurs mobilières complexes avec effet dilutif immédiat
Il s’agit de titres dont la composante principale est une action, créant immédiatement une augmentation de capital dilutive pour les associés existants. Ces instruments obligent l’AGE à se prononcer sur une résolution en faveur des salariés.
Exemples :
-
ABSA : Actions assorties de bons de souscription d’actions,
-
ABSOCA : Actions assorties de bons de souscription d’obligations convertibles.
Typologie : titre primaire = action → dilution immédiate → obligation L.225-129-6.
2.2. Valeurs mobilières complexes avec effet dilutif à terme
Ces instruments ne créent pas de dilution immédiate. La création d’actions nouvelles est subordonnée à une décision ultérieure et individuelle du porteur : exercice, conversion ou remboursement.
Exemples :
-
OBSA : Obligations assorties de bons de souscription d’actions,
-
OCA : Obligations convertibles en actions,
-
ORA : Obligations remboursables en actions,
-
BSA : Bons de souscription d’actions (détachés).
Typologie : titre primaire = obligation ou droit dérivé = dilution potentielle différée = pas d’obligation L.225-129-6.
2.3. Valeurs mobilières sans effet dilutif
Certaines valeurs mobilières ne créent aucune création de titres nouveaux ni effet dilutif. Elles sont structurées sur la base de titres de créance simples ou de droits d’accès à des actions déjà existantes.
Exemples :
-
OBSO : Obligations assorties de bons de souscription d’obligations,
-
OARE : Obligations remboursables en actions existantes,
-
BSO : Bons de souscription d’obligations,
-
BAA : Bons d’acquisition d’actions existantes.
Typologie : aucun impact sur le capital = hors champ de l’article L.225-129-6.
3. Lecture doctrinale et position des autorités professionnelles
L’ANSA, dans son avis n°04-024 (2004), a adopté une lecture fonctionnelle du texte : l’obligation ne s’impose que si le titre émis emporte une augmentation de capital immédiate. À l’inverse, lorsque le titre est obligataire (OCA, ORA, OBSA), l’augmentation de capital est seulement potentielle, conditionnée à l’initiative du porteur. Le texte vise une "augmentation résultant" de l’émission, non une augmentation dérivée et différée.
La CNCC, dans ses bases doctrinales, adopte la même grille de lecture, fondée sur l’effet dilutif et la nature du titre primaire. Elle qualifie les titres en trois blocs : valeurs avec dilution immédiate, dilution à terme, ou sans dilution.
Cette interprétation n’a pas été contredite par la jurisprudence et demeure communément suivie en pratique, sous réserve d’un examen au cas par cas.
4. Conclusion
L’article L.225-129-6 du Code de commerce, bien que fondé sur une logique d’inclusion salariale, n’impose pas une obligation généralisée d’inscription d’une résolution "PEE". L’analyse de la structure juridique de l’instrument émis — et notamment la distinction entre action et obligation comme titre primaire — permet de tracer une ligne claire entre les cas où la société doit prévoir une telle résolution, et ceux où elle peut valablement s’en dispenser.

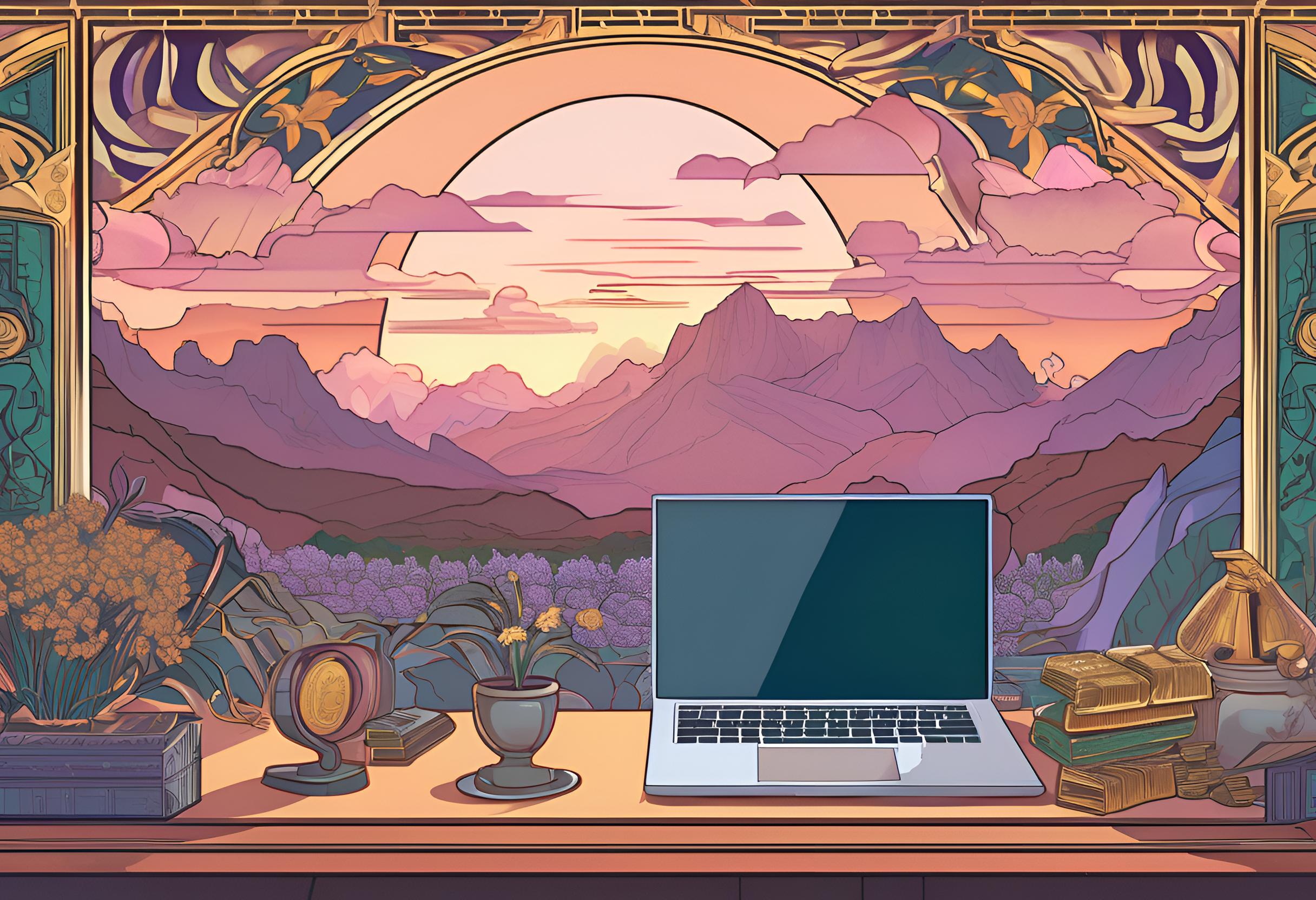
Pas de contribution, soyez le premier