Dans un monde de plus en plus mobile, les parcours de vie dépassent souvent les frontières. Parmi les nombreux exemples de cette internationalisation des trajectoires personnelles et familiales, les liens étroits entre la France et la Belgique illustrent particulièrement bien les défis que peut poser une succession transfrontalière.
Que l’on soit résident belge avec des héritiers en France, citoyen français ayant acquis un bien en Belgique, ou tout simplement une famille éclatée entre les deux pays, les questions liées à l’héritage deviennent rapidement complexes, à la fois d’un point de vue fiscal, civil et administratif.
La proximité géographique, linguistique et culturelle entre la France et la Belgique encourage de nombreux citoyens à s’installer de part et d’autre de la frontière. Retraite plus douce en Wallonie, fiscalité réputée plus avantageuse en matière de succession côté belge, attaches familiales ou opportunités professionnelles de l’autre côté du Quiévrain : les raisons de vivre, investir ou transmettre dans l’un ou l’autre pays sont multiples.
Mais cette fluidité apparente des mouvements dissimule une réalité bien plus ardue lorsqu’il s’agit de succession. Car derrière chaque héritage se cache un dédale de règles, de lois et d’interprétations, souvent contradictoires ou mal connues.
La France, fidèle à sa tradition de droit civil, encadre de façon stricte les successions : réserves héréditaires, fiscalité rigoureuse, obligations déclaratives nombreuses. La Belgique, quant à elle, bien qu’elle partage un socle juridique similaire, offre plus de flexibilité dans la répartition des biens, et surtout une fiscalité successorale très variable d’une région à l’autre (Flandre, Wallonie, Bruxelles), souvent perçue comme plus favorable.
Pourtant, croire que l’on peut échapper à toute imposition en organisant une succession “à la belge” serait une erreur de calcul. En effet, les autorités fiscales françaises peuvent, dans de nombreux cas, réclamer leur dû, même si le défunt ou ses héritiers résident à l’étranger.
Les pièges sont nombreux : domiciliation fiscale mal définie, double imposition en cas de biens situés dans les deux pays, mauvaise application des conventions internationales, donations mal structurées, ou encore ignorance des règles européennes sur les successions transfrontalières. Il en résulte souvent des tensions familiales, des retards de règlement, voire des redressements fiscaux importants, qui auraient pu être évités par une planification réfléchie.
C’est donc dans ce contexte que se pose une question essentielle : comment anticiper et éviter les principaux pièges d’une succession franco-belge ? Cette interrogation renvoie à la fois à une bonne connaissance des législations nationales, à l’application de la convention fiscale franco-belge du 20 janvier 1959, ainsi qu’au règlement européen n°650/2012 qui encadre les successions transfrontalières au sein de l’Union européenne. Mais au-delà du droit, elle suppose également une approche humaine, sensible aux spécificités de chaque situation familiale, patrimoniale et affective.
Dans les pages qui suivent, nous explorerons les différents écueils possibles, tout en proposant des solutions concrètes pour organiser au mieux la transmission d’un patrimoine entre la France et la Belgique. Car anticiper, c’est éviter bien des malentendus, des coûts inutiles, et garantir que la volonté du défunt soit respectée, sans laisser à ses proches un fardeau juridique et fiscal difficile à porter.
I. Cadre juridique : compétence, loi applicable et sécurité des volontés
A. Le règlement (UE) n° 650/2012 : principes d’unification partielle du droit des successions
Le règlement (UE) n° 650/2012, entré en application le 17 août 2015, constitue la pierre angulaire du droit successoral international dans l’Union européenne (hors Danemark et Irlande). Il vise à harmoniser la loi applicable aux successions transfrontalières et à garantir la reconnaissance des décisions successorales dans tous les États membres concernés.
1. La règle de la résidence habituelle
Conformément à l’article 21 du règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. Cette règle s’applique même si le défunt possédait des biens dans plusieurs pays.
2. L’exception : professio juris (choix de loi nationale)
L’article 22 du règlement permet au testateur de choisir la loi de sa nationalité (ou l’une d’entre elles s’il a plusieurs nationalités) pour régir sa succession. Cela permet notamment à un Français résidant en Belgique de faire primer le droit français sur le droit belge, notamment pour protéger ses héritiers réservataires ou assurer une gestion successorale plus familière.
Cependant, ce choix doit être exprès, c’est-à-dire consigné dans un testament, rédigé selon les formes admises (notarié ou olographe).
B. Reconnaissance mutuelle et limites : le rôle du certificat successoral européen et l’ordre public
1. Le certificat successoral européen (CSE)
Le règlement a aussi instauré le certificat successoral européen (CSE), destiné à faciliter les démarches dans les successions transfrontalières. Il permet aux héritiers, légataires ou exécuteurs testamentaires de prouver leur qualité à l’étranger, sans devoir obtenir un jugement d’homologation dans chaque pays.
2. L’exception d’ordre public international
Cependant, le règlement prévoit une clause de sauvegarde : un État membre peut refuser l’application d’une disposition étrangère qui serait manifestement incompatible avec ses principes fondamentaux, notamment la protection des héritiers réservataires.
II. Fiscalité et arbitrage entre France et Belgique
A. Analyse comparative des régimes fiscaux successoraux
1. Belgique : une fiscalité régionale et variable
Contrairement à la France, la Belgique ne possède pas un barème fiscal unique. Les Régions (Wallonie, Bruxelles-Capitale, Flandre) disposent chacune de leurs propres taux et abattements. Les droits de succession belges dépendent du lien de parenté et de la valeur nette de l’héritage.
Par exemple :
- En Wallonie, les droits peuvent atteindre jusqu’à 30 % entre parents en ligne directe, et 80 % entre non-parents.
- La Flandre est plus clémente : taux de 3 à 27 % en ligne directe, et abattement de 50 000 € pour le conjoint survivant.
- Aucun abattement n’est systématiquement prévu en Belgique, contrairement à la France.
2. France : abattements et imputation fiscale
La France accorde un abattement de 100 000 € par enfant, et les conjoints/pacsés sont exonérés de droits.
Les taux sont progressifs :
- De 5 à 45 % en ligne directe,
- Jusqu’à 60 % entre non-parents.
En cas de succession mixte, la France impose :
- Le patrimoine mondial du défunt si le défunt ou l’héritier est fiscalement domicilié en France depuis plus de 6 ans sur les 10 dernières années.
- Un mécanisme d’imputation (article 784 A du CGI) permet d’éviter une double imposition si des droits ont déjà été acquittés à l’étranger (notamment en Belgique).
B. Stratégies d’optimisation successorale : pour éviter les pièges fiscaux
1. Usufruit successif et réversion de donation
La donation avec réserve d’usufruit, voire avec clause de réversion, est très utilisée en planification franco-belge. Elle permet de transmettre la nue-propriété d’un bien en gardant son usage.
Il est donc essentiel d’analyser le droit local applicable à la résidence et au bien, et d’éventuellement renoncer à l’usufruit avant le décès pour éviter une requalification fiscale.
2. Legs croisé, double legs et legs caritatifs
Par exemple, un legs à une association caritative exonérée de droits (en Belgique ou France) peut permettre de limiter la taxation globale de la succession. Ces stratégies nécessitent cependant un conseil notarial précis pour respecter les législations des deux États et éviter une double imposition.
Sources :
- Règlement (UE) n°650/2012 – Article 21
- Accueil | Notaires de France
- https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199805&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2684780
- Particuliers | SPF Finances
- Accueil | bofip.impots.gouv.fr
- Fédération Royale du Notariat belge – Planification successoraleNotaires de France – Les stratégies patrimoniales internationales
- Notaires de France – Les stratégies patrimoniales internationales

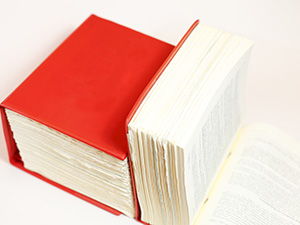
Pas de contribution, soyez le premier