L'article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit une sanction procédurale spécifique en cas d'inaction du titulaire d'une marque. Toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi, est irrecevable.
Celui qui tolère l'enregistrement d'une marque constituant une contrefaçon de son bien intellectuel, qui ne saisit par l'opportunité éventuelle d'une opposition et qui ensuite tolère l'usage du bien durant cinq ans n'est plus recevable à agir en contrefaçon. Cette sanction laisse cohabiter les deux signes distinctifs en cause, seule l'action en justice ne peut être engagée, ce qui écarte la possibilité d'en demander l'annulation, sous réserve du risque de confusion pour le consommateur. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
La Cour de cassation précise, au visa de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, que, selon l'article 9, paragraphe 2 de la directive no 89/104, lorsqu'il exerce l'option ouverte par ce texte, un État membre peut prévoir que le paragraphe 1 de ce texte s'applique, non seulement au titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 4, paragraphe 4, point a), mais aussi au titulaire d'un des autres droits antérieurs visés à l'article 4, paragraphe 4, point b) ou c) de cette directive (Com. 16 févr. 2010, préc.).
En exerçant cette option, la loi française accorde une protection identique au propriétaire d'une marque, quelle que soit la nature du droit fondant la demande dirigée à son encontre. L'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle impose, à la lumière du droit de l'Union, que le propriétaire d'une marque qui a toléré en France l'usage d'une marque postérieure enregistrée en France pendant une période de cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque a été utilisée, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.
La tolérance ne suppose pas que le titulaire de la marque ait admis, ne serait-ce que tacitement, l'usage de la marque seconde, mais seulement qu'il se soit abstenu de s'y opposer en connaissance de cause. Encore faut-il qu'il ait juridiquement pu le faire ; la Cour de justice a considéré que le titulaire d'une marque antérieure ne peut être réputé avoir toléré un usage par un tiers d'une marque postérieure s'il était privé de toute autre possibilité de s'opposer à cet usage (CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-482/09, Budějovický Budvar c/ Anheuser-Busch, EU:C:2011:605, Propr. intell. 2012, no 42, p. 58, note G. Bonet, à propos de la marque Budweiser).
- Conditions permettant d'invoquer la forclusion par tolérance en faveur d'une marque
- Condition procédurale de la forclusion par tolérance
La forclusion par tolérance ne constitue qu'une fin de non-recevoir qui ne peut être invoquée que dans le cadre de la défense à une action en contrefaçon ou en nullité mise en œuvre par le titulaire du droit antérieur premier en date. En d'autres mots, en aucun cas le titulaire de la marque seconde ne peut agir au principal pour faire reconnaître de façon préventive l'existence de la forclusion par tolérance à son bénéfice. La forclusion par tolérance n'est donc pas un droit objectif directement attaché à la marque seconde en date, sauf après décision judiciaire définitive l'ayant reconnue (et encore sous la réserve importante que le bénéfice de la forclusion par tolérance est limité aux produits et services ayant effectivement fait l'objet de l'usage toléré).
Si la possibilité d’invoquer la forclusion par tolérance à l’encontre du titulaire de la marque antérieure est explicite dans les textes français et communautaires : “lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré” (CPI, art. L. 716-4-6) et “le titulaire d’une marque antérieure […] qui a toléré” (dir. 2015/2436, art. 9), une incertitude demeure quant à la possibilité de l’invoquer à l’encontre d’un licencié ou d’un licencié exclusif, qui disposent aux termes de l’article L. 716-4-2 de la faculté d’agir en contrefaçon sous certaines conditions.
- Conditions relatives à la marque seconde
- La marque seconde doit être enregistrée
Les textes communautaires applicables (directive et règlement) précisent très clairement que le signe second doit être une marque enregistrée. Concernant la loi française, cette condition est clairement explicitée dans le nouvel article L. 716-2-8. En revanche, le nouvel article L. 716-4-5, contrairement à l’ancien article L. 716-5, ne mentionne plus expressément que la marque seconde doit être « enregistrée ». Cela étant, le texte du nouvel article doit être lu à la lumière de la directive, qui, quant à elle, fait référence à une marque postérieure “enregistrée”, exigence désormais bien établie dans la jurisprudence tant communautaire que française.
La forclusion par tolérance ne peut également s'appliquer en faveur du simple utilisateur exploitant un signe contrefaisant. Cela nous semble être une conséquence indirecte du système français du droit des marques par lequel seul le dépôt est attributif de droit. Lorsque le simple utilisateur d'un signe distinctif est en plus contrefacteur, il n'y a aucune raison de le faire bénéficier d'une disposition dérogatoire et favorable de la loi. À noter également, qu'en principe, l'existence d'une marque enregistrée entraîne l'irrecevabilité d'une demande fondée sur l'article L. 716-2-7 (anciennement L. 714-4) du Code de la propriété intellectuelle (supra en introduction) relatif aux marques notoirement connues (TGI Paris, 26 oct. 1999 : PIBD 2000, n° 696, III, p. 199). L'on comprend bien le souhait du défendeur de se fonder sur cette dernière disposition du Code de la propriété intellectuelle, les conditions de son application étant en effet plus attrayantes, car elles ne nécessitent pas la démonstration de la connaissance de l'exploitation par le titulaire antérieur.
La seconde chambre des recours de l'OHMI en date du 21 octobre 2008 (OHMI, 2e ch. rec., 21 oct. 2008, n° R1299/2007-2, A. Cristanini c/ Ghibli SpA : http://oami.europa.eu/) a précisé dans une affaire fort intéressante que la date d'enregistrement de la marque communautaire seconde est la date la plus ancienne qui peut être retenue dans le cadre du calcul des 5 années de forclusion par tolérance. En d'autres termes, même si le titulaire du droit antérieur était en connaissance de l'exploitation de la marque communautaire seconde depuis la date de son dépôt, le délai ne commence à courir qu'à compter de la date d'enregistrement. L'usage à titre de marque communautaire ne peut en effet techniquement commencer qu'à compter de l'enregistrement de cette dernière selon la seconde chambre des recours. Évidemment, si la connaissance de l'exploitation est postérieure à l'enregistrement, doit être retenue comme point de départ la date de cette prise de connaissance.
- Le dépôt de la marque seconde doit avoir été effectué de bonne foi
Conformément au droit commun, la bonne foi est toujours présumée et il revient au titulaire du droit antérieur de prouver que le déposant second était de mauvaise foi afin de résister à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance. Un cas assez évident de mauvaise foi concerne l'hypothèse dans laquelle le déposant second était licencié du droit antérieur qu'il contrefait. Cette hypothèse pourrait aussi s'étendre par exemple à un distributeur des produits ou services du premier titulaire.
Problématique des recherches d'antériorités – Sauf à priver cette fin de non-recevoir de presque tout son intérêt, il n'est pas approprié de soutenir que – le dépôt d'une marque devant, dans les règles de l'art, s'accompagner d'une recherche d'antériorités – tout déposant s'abstenant de procéder aux investigations minimales concernant la disponibilité serait présumé être de mauvaise foi. En ce sens, la Cour de cassation a pu préciser que :
Dans le même sens :
La chambre commerciale de la Cour de cassation a aussi donné quelques précisions sur cette notion de bonne foi appliquée à la forclusion par tolérance dans un arrêt du 6 mars 2007 ; la faible distinctivité de la marque prétendue contrefaite permet d'écarter la mauvaise foi du déposant de la marque postérieure contestée :
en retenant qu'une telle mauvaise foi ne saurait se déduire de la seule connaissance de la marque première, que la marque seconde n'en constitue pas la reproduction, et que le signe contesté s'inscrit dans une tradition, la cour d'appel, qui a caractérisé la simple utilisation, sous une forme différente, d'un signe usuel dans la profession, a pu écarter ce grief et a ainsi justifié sa décision.
- La marque seconde doit être exploitée
Le simple titulaire d'une marque seconde ne peut invoquer à son profit la forclusion par tolérance à défaut d'exploitation. L'esprit de la directive et de la loi est de protéger à terme un concurrent de bonne foi qui a procédé à des investissements pour promouvoir sa marque en méconnaissance du vice affectant son titre. À défaut d'investissements sur la marque à protéger, et donc d'exploitation, la loi n'a aucune raison de favoriser ce titulaire.
En droit des marques « la propriété est active, ce qui signifie qu'elle n'admet pas la passivité du propriétaire ». Cette citation s'applique aussi en l'espèce ; si la propriété de la marque seconde reste inactive, la loi n'a aucune raison de la protéger, tout comme elle ne protège pas le titulaire d'un droit antérieur du risque de déchéance pour cause de non-usage, pour cause de dégénérescence ou encore du risque de la forclusion par tolérance.
La jurisprudence que nous évoquerons au paragraphe suivant concernant la notion de tolérance sera évidemment applicable à cette condition de l'exploitation.
La charge de la preuve de cette exploitation incombe, conformément au droit commun, au titulaire de la marque seconde. Par exemple (TGI Bordeaux, 15 oct. 2002 : JurisData n° 2002-190585) : C'est au titulaire de la marque postérieure qui se prévaut de la forclusion par tolérance d'établir la réalité de l'exploitation de sa marque et de son exploitation effective au vu et su du concurrent depuis plus de 5 ans.
- Conditions tenant au titulaire du droit antérieur
- La connaissance de l'exploitation de la marque seconde
L'expression « en connaissance de cet usage » figurant tant dans les textes communautaires que désormais dans les nouvelles dispositions françaises est un indice précieux de la volonté du législateur. Ce dernier, contrairement à d'autres causes de prescription qui ne nécessitent que l'écoulement d'un certain laps de temps, a souhaité introduire comme critère l'inaction du titulaire, en connaissance de cause.
S'il a ignoré l'exploitation de la marque seconde, la forclusion par tolérance ne peut trouver matière à application. Comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4e ch., sect. A, 20 sept. 2000, n° 1999/15600 : JurisData n° 2000-127788), « la tolérance implique nécessairement la connaissance de l'usage créateur de droit ». Selon le professeur Ch. Caron, « La tolérance est donc consubstantielle à la connaissance : on ne peut tolérer que ce qu'on connaît ».
En matière de forclusion par tolérance, la notion d'usage s'avère finalement plus importante téléologiquement que la notion de marque enregistrée, même si cette dernière condition reste tout aussi obligatoire. Une décision précitée de la seconde chambre des recours de l'OHMI en date du 21 octobre 2008 (OHMI, 2e ch. rec., 21 oct. 2008, n° R1299/2007-2, préc. n° 16) est très explicite sur ce point : (en substance) l'enregistrement de la marque communautaire seconde peut avoir échappé à la connaissance du titulaire du droit antérieur car ce n'est qu'une condition objective, mais ce qui importe est qu'il ait eu connaissance de l'usage de ce signe, ce qui est une condition subjective.
Interprétation de la notion de tolérance – Dans un arrêt du 31 mai 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que « la tolérance de la marque seconde ne suppose pas que le titulaire de la marque première ait admis, même tacitement, son usage, mais seulement qu'il se soit abstenu, en connaissance de cause, de s'y opposer ». Tolérer n'est donc pas admettre, ce qui aurait été encore plus difficile à prouver. Tolérer est simplement ne pas avoir réagi alors que l'on savait, sans prendre en considération les raisons de cette inaction (volonté réelle d'accepter ou simple négligence).
La Cour de justice de l’Union européenne se livre à l’analyse de la notion de tolérance (arrêt précité CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-482/09, Budejovický Budvar, národní podnik c/ Anheuser-Busch Inc) jugeant que la « tolérance » constitue une notion du droit de l’Union, dont le sens et la portée doivent être identiques dans l’ensemble des États membres. La Cour de justice souligne par ailleurs que la « tolérance » se distingue du « consentement », lequel doit être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine la volonté de renoncer à un droit. Celui qui tolère fait preuve de passivité en s’abstenant de prendre les mesures dont il dispose pour remédier à une situation dont il a connaissance et qui n’est pas nécessairement souhaitée. En d’autres termes, la notion de « tolérance » implique que celui qui tolère reste inactif en présence d’une situation à laquelle il aurait la possibilité de s’opposer.
La connaissance de l'exploitation fait courir le délai quinquennal – Selon le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 23 juin 2000 : PIBD 2000, n° 707, III, p. 522), le délai quinquennal de forclusion par tolérance, auquel font référence les articles L. 716-2-8 et L. 716-4-5 (anciennement CPI, art. L. 714-3, al. 4, et L. 716-5, al. 4), doit être calculé à partir du jour où le titulaire du droit antérieur a eu connaissance de l'usage de la marque prétendument contrefaisante.
Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mars 2006 s'avère instructif à ce sujet :
La chambre commerciale reproche donc à la cour de Paris d'avoir considéré la date du dépôt de la marque seconde litigieuse comme point de départ du délai de forclusion :
En se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances dans lesquelles le dépôt de la marque seconde, qui n'a pas en lui-même de caractère public, avait porté l'existence de celle-ci à la connaissance du titulaire de la marque première, et sans examiner la nature et la date des faits d'usage de cette marque seconde, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dans le même sens :
Il ne faut pas confondre tolérance et ignorance comme le souligne le professeur Ch. Caron.
Ce sont les faits d'usage qui font courir le délai de forclusion par tolérance et non pas la date de dépôt de la marque seconde, qui est inopérante de ce point de vue (en ce sens V. également, CA Paris, 17 nov. 2017, n° 16/20736 : PIBD 2018, III, p. 94, le point de départ du délai ne peut être la date de l'enregistrement de la marque, non plus que celle de son octroi, mais la connaissance par le demandeur de l'usage effectif de la marque seconde).
Dans les deux cas c'est la connaissance de l'usage de la marque qui doit avoir été toléré durant 5 années pour entraîner la forclusion de l'action en nullité ou l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon. Dès lors, le point de départ de ces délais ne peut être celui de la publication de la demande d'enregistrement de la marque, ni même de son octroi mais doit être apprécié, au cas d'espèce, par la connaissance de l'usage effectif de la marque seconde.
- La tolérance doit avoir duré cinq années
Ce sujet est à l'heure actuelle toujours d'un très grand intérêt et les enseignements de la jurisprudence doivent être appliqués par tous les praticiens. Ayant traité préalablement de la question du point de départ de ce délai de cinq années, il convient désormais de s'attarder sur les moyens d'interrompre ce délai au combien dangereux pour le titulaire du droit antérieur.
Le premier réflexe de tout praticien est bien souvent de conseiller à son client l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure au commerçant second indélicat. Il est vrai que la lettre recommandée est un outil peu onéreux pour essayer de faire respecter ses droits. Toute la question est de savoir si cet outil est à lui seul capable d'interrompre le délai de forclusion par tolérance ou s'il faut impérativement recourir aux actes limitativement énumérés par le Code civil concernant les délais de prescription.
Le délai de cinq ans prévu par l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle est un délai préfix ou encore un délai de forclusion (...) qui exige de la part du titulaire de la marque première de manifester de façon positive et non équivoque son intention de contester la marque seconde ; que cette manifestation ne saurait résulter d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée, mais comme l'exige l'article 2244 du Code civil, d'une citation en justice ou d'un commandement destiné à interrompre le délai pour agir.
La chambre commerciale de la Cour de cassation consacre une solution identique à celle de la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 25 février 2003(D. 2003, p. 2690, obs. S. Durrande ; RJDA 7/2003, n° 788, p. 695) tout en énonçant que la forclusion par tolérance constitue un cas de prescription de l'action en justice et que, de fait, conformément aux dispositions de l'article 2244 du Code civil, seule une citation en justice, en référé ou non, un commandement ou une saisie peuvent interrompre ce délai ; une mise en demeure adressée par lettre recommandée n'entraîne aucune interruption du délai. Elle a de nouveau statué en ce sens dans un arrêt du 8 mars 2005 en qualifiant le délai de forclusion et non de prescription.
Dans un arrêt du 31 mai 2005 (14) la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que :
Les décisions examinées, y compris lorsqu'elles émanent de la Cour de cassation varient entre la qualification de prescription et celle de forclusion. Sur la question de l'admission des simples mises en demeure pour suspendre le délai, cette qualification est sans intérêt car, dans les deux cas, il est admis qu'elles ne le peuvent. Pour un approfondissement de ce sujet, voir l'article de Th. Lancrenon (Th. Lancrenon, Une lettre de mise en demeure n'est pas de nature à interrompre le délai de forclusion par tolérance : D. 2005, p. 2021).
Cet auteur s'oriente vers la qualification de délai de forclusion pour la raison suivante « ... la rédaction des articles L. 714-3 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle [à présent CPI, art. L. 716-2-8 et L. 716-4-5] confirme qu'en cas de tolérance, c'est bien l’“action” du titulaire de la marque qui est irrecevable, ce n'est pas le droit qui est prescrit. Dans ces conditions, le délai de cinq ans nous semble devoir être qualifié de délai de forclusion ». Cette qualification n'est pas sans intérêt pratique, notamment sur le point de savoir si le juge peut se saisir d'office, sur l'applicabilité de toutes les dispositions relatives aux délais de prescriptions du Code civil.
Sources :

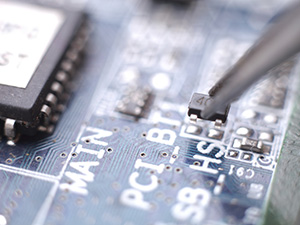
Pas de contribution, soyez le premier