A la Biennale des Antiquaires de septembre 2012, X a acquis auprès de Y, antiquaire, 2 objets :
- un vase en porcelaine de Céladon, orné de bronzes ciselés et dorés, XVIIIe siècle : 2,8 M€
- un miroir en bronze ciselé, doré et argenté, XVIIIe siècle : 100.000 €
Y a ensuite fait l’objet de rumeurs, la presse révélant l’existence d’une procédure pénale le mettant en cause, concernant la vente de faux objets du XVIIIe siècle.
X a alors fait analyser le vase et le miroir par un expert privé, qui a émis des doutes quant à l’attribution des objets à l’époque Louis XVI.
X a ensuite assigné Y devant le TCom de Paris aux fins d’annulation des 2 ventes.
Le 14 septembre 2021, le TCom de Paris a rejeté les demandes de X.
Les juges ont d’abord rappelé que « il ne revient pas au tribunal de décider de l’authenticité de l’objet […] mais de juger si le demandeur a démontré qu’il existait un doute justifié, sérieux et alimenté par des éléments précis sur ladite authenticité ».
En l’espèce, X n’a pas fait le choix de recourir à un expert judiciaire sur la base de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le tribunal a donc rendu sa décision sur la base des preuves versées de part et d’autre, à savoir :
Pour X :
- une analyse de la composition des bronzes par un laboratoire sous la direction d’un expert près la cour d’appel
- une analyse scientifique et stylistique d’un ébéniste et expert (pas expert près la cour d’appel)
- une analyse scientifique et stylistique d’un artisan horloger
- un rapport d’un laboratoire d’art
- une analyse stylistique et d’assemblage d’un bronzier d’art et restaurateur d’art métallique
- un article d’une historienne d’art américaine
- divers ouvrages, photos, comparaisons d’œuvres etc.
Pour Y :
- une expertise sur photos par un expert près la cour d’appel et agréé auprès de la cour de cassation depuis 30 ans, ancien restaurateur des musées de France et ancien adjoint au chef des ateliers du château de Versailles
- une attestation d’un expert près la cour d’appel
- divers factures, courriers, ouvrages etc.
Les juges ont ainsi examiné successivement la teneur en plomb, la dorure des bronzes, le re-ciselage des bronzes, la taille du vase, l’analyse stylistique etc., et disqualifié une à une toutes les preuves de X.
La lecture du jugement est très instructive !
Et pour une approche moins juridique et plus croquignolesque, il faut lire l’article de Marc Leplongeon dans Le Point : https://lnkd.in/drP6qPwJ.

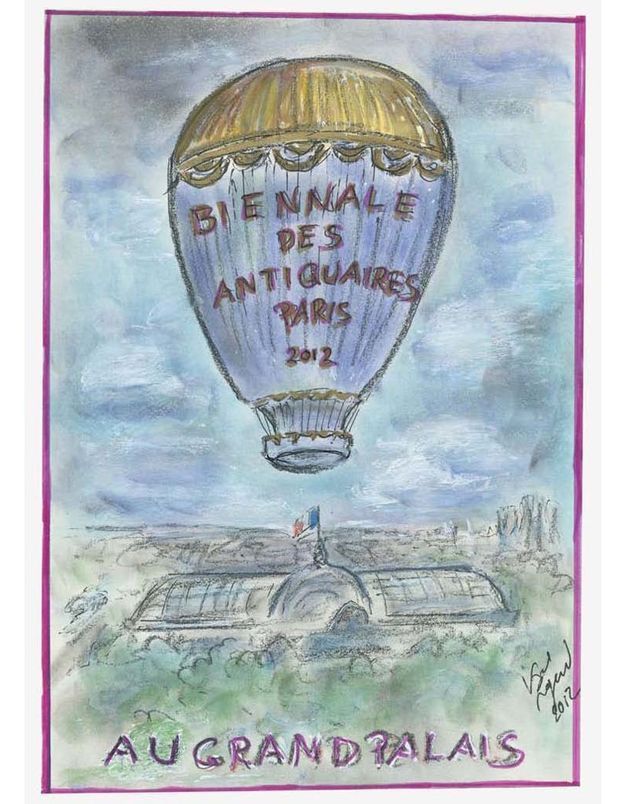
Pas de contribution, soyez le premier