La pollution atmosphérique générée par les navires constitue une préoccupation majeure en matière de droit de l'environnement et de santé publique. Les émissions de ces bâtiments, notamment en oxydes de soufre (SOx), oxydes d'azote (NOx) et particules fines, contribuent significativement à la dégradation de la qualité de l'air et au changement climatique. La question de la preuve de cette pollution revêt une importance capitale, tant pour la mise en œuvre des réglementations que pour la répression des infractions. La preuve de la pollution atmosphérique des navires présente des spécificités distinctes. Les navires opèrent souvent dans des zones internationales, rendant la compétence juridictionnelle complexe. De plus, les conditions météorologiques et maritimes peuvent affecter la dispersion des polluants, compliquant la corrélation directe entre un navire spécifique et une pollution observée. Ces défis nécessitent une approche combinant surveillance technologique, coopération internationale et cadres juridiques adaptés. Pour répondre à ces défis, plusieurs outils juridiques ont été développés. L'Annexe VI de la Convention MARPOL établit des zones de contrôle des émissions (ECA) où des normes d'émission plus strictes s'appliquent, et les États membres sont encouragés à utiliser des technologies de surveillance pour assurer le respect de ces normes. En Europe, la directive (UE) 2016/802, connue sous le nom de "directive soufre", impose des limites à la teneur en soufre des combustibles marins et prévoit des mesures de surveillance et d'application, y compris des inspections des navires et l'utilisation de technologies de détection à distance.
I. Cadre juridique et méthodes actuelles de preuve de la pollution atmosphérique des navires
A. Cadre juridique international et national
1. La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et son Annexe VI
La Convention MARPOL, adoptée en 1973 et modifiée par le Protocole de 1978, constitue le principal instrument juridique international visant à prévenir la pollution marine par les navires. Son Annexe VI, adoptée en 1997, établit des limites strictes sur les émissions de polluants atmosphériques, notamment les SOx et les NOx, provenant des gaz d'échappement des navires. Elle prévoit également la création de zones de contrôle des émissions (ECA) où des normes plus sévères s'appliquent.
2. Réglementation européenne sur la pollution atmosphérique des navires
L'Union européenne a adopté des mesures spécifiques pour réduire la pollution atmosphérique provenant des navires. La directive (UE) 2016/802, dite "directive sur la teneur en soufre", impose des limites strictes à la teneur en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux européennes. Depuis le 1er janvier 2020, la teneur maximale en soufre des combustibles marins est fixée à 0,50 % en masse, conformément aux amendements de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. De plus, des zones de contrôle des émissions de soufre (SECA) ont été établies en mer Baltique et en mer du Nord, où la teneur en soufre des combustibles ne doit pas dépasser 0,10 %.
En outre, l'Union européenne a mis en place le règlement (UE) 2015/757 relatif à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) provenant du transport maritime. Ce règlement oblige les armateurs à surveiller et à déclarer les émissions de CO₂ de leurs navires de plus de 5 000 tonneaux de jauge brute effectuant des voyages à destination ou en provenance de ports situés dans l'Espace économique européen.
Ces mesures illustrent l'engagement de l'Union européenne à compléter le cadre juridique international en matière de prévention de la pollution atmosphérique par les navires, en imposant des normes plus strictes et en renforçant les mécanismes de surveillance et de conformité.
3. Transposition en droit français : ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021
En France, l'ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 a renforcé les sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires, conformément aux obligations internationales. Elle prévoit notamment des amendes significatives et des peines d'emprisonnement en cas de non-respect des normes d'émission établies par la Convention MARPOL. Elle introduit des sanctions en cas de manquement aux obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du secteur du transport maritime, conformément au règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015. Ce règlement impose aux armateurs de surveiller et de déclarer les émissions de CO₂ de leurs navires afin de réduire l'impact environnemental du transport maritime. L'ordonnance étend l'application des sanctions prévues aux infractions commises dans les collectivités d'outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Cette extension vise à assurer une protection environnementale cohérente sur l'ensemble du territoire français.
B. Méthodes actuelles de surveillance et de preuve
1. Surveillance des émissions à bord des navires
Les navires de plus de 400 tonneaux de jauge brute sont tenus de détenir un certificat de prévention de la pollution de l'air à bord, attestant de leur conformité aux normes d'émission en vigueur. Des inspections régulières sont effectuées par les autorités compétentes pour vérifier le respect de ces normes.
2. Mesures environnementales locales autour des ports
En vertu de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale, qui comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les pollutions de toute nature, tels que les pollutions atmosphériques. Ce pouvoir de police générale permet au maire de prendre des mesures pour assurer la salubrité publique sur le territoire communal.
Concernant les espaces maritimes, les maires des communes littorales exercent des pouvoirs de police spéciale dans la bande des 300 mètres à compter de la limite des eaux, notamment pour la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins non immatriculés. Toutefois, la police de la navigation et la lutte contre la pollution en mer relèvent principalement de la compétence de l'État, exercée par le préfet maritime.
Conscients des enjeux environnementaux et sanitaires liés aux émissions des navires de croisière, les maires de Cannes et de Nice ont mis en place des mesures pour limiter leur impact.
-
Ville de Cannes : Depuis 2019, le maire de Cannes, David Lisnard, a instauré une charte environnementale imposant aux opérateurs de croisière une limitation de la teneur en soufre de leur carburant à 0,1 % pour pouvoir débarquer leurs passagers à Cannes. Cette initiative vise à réduire les émissions de polluants atmosphériques lors des escales.
-
Ville de Nice : En 2024, le maire de Nice, Christian Estrosi, a signé un arrêté municipal interdisant l'accès au port aux navires de croisière les plus imposants, dans le but de lutter contre le surtourisme et de réduire la pollution atmosphérique. Cette mesure vise à limiter l'impact environnemental des grandes unités sur la qualité de l'air local.
Bien que les maires puissent prendre des mesures pour protéger l'environnement et la santé publique, leurs compétences en matière de régulation du trafic maritime restent limitées, notamment en ce qui concerne la navigation en mer et les aspects techniques des navires, qui relèvent de la compétence de l'État. Cette répartition des compétences peut restreindre la capacité des maires à imposer des restrictions aux navires de croisière.
Face à ces limitations, certains élus locaux plaident pour un élargissement des pouvoirs des maires en mer, afin de leur permettre de réguler plus efficacement le trafic maritime et de protéger l'environnement côtier. Cette évolution nécessiterait une adaptation du cadre législatif actuel pour renforcer les prérogatives des collectivités territoriales en matière de police administrative maritime.
3. Modélisation et études scientifiques pour estimer l'impact du trafic maritime
Des recherches, telles que celle menée par Léo Zabrocki et al., utilisent des approches statistiques pour estimer l'impact du trafic maritime sur la pollution locale, en se basant sur des données observationnelles. Les auteurs ont adopté une approche innovante pour estimer les effets causals du trafic maritime sur la pollution de l'air en l'absence d'expériences naturelles ou de politiques spécifiques. Ils ont utilisé un algorithme de mise en correspondance conçu pour les séries temporelles afin de créer des expériences randomisées hypothétiques. Cette méthode leur a permis d'estimer les variations des concentrations de polluants atmosphériques résultant d'une augmentation ponctuelle du trafic de croisière. Les données analysées couvrent la période de 2008 à 2018 et incluent des informations sur le trafic des navires de croisière, les paramètres météorologiques et les concentrations de divers polluants atmosphériques.
L'étude révèle que les arrivées de navires de croisière ont un impact significatif sur les concentrations horaires de plusieurs polluants à l'échelle de la ville :
-
Dioxyde d'azote (NO₂) : augmentation de 4,7 µg/m³ (intervalle d'incertitude de 95 % : [1,4 ; 8,0]).
-
Dioxyde de soufre (SO₂) : augmentation de 1,2 µg/m³ (intervalle d'incertitude de 95 % : [-0,1 ; 2,5]).
-
Particules en suspension (PM10) : augmentation de 4,6 µg/m³ (intervalle d'incertitude de 95 % : [0,9 ; 8,3]).
Ces augmentations sont observées au niveau horaire, suggérant un effet immédiat du trafic de croisière sur la qualité de l'air. Toutefois, à l'échelle quotidienne, l'impact du trafic routier sur les concentrations de NO₂ et de PM10 semble prédominant par rapport à celui du trafic de croisière.
II. Évolutions récentes et perspectives d'harmonisation de la preuve de la pollution atmosphérique des navires
A. Innovations technologiques et adaptation du cadre juridique
1. Utilisation de capteurs "renifleurs" et de drones pour la détection des émissions
Depuis 2015, la Belgique utilise un capteur "renifleur" installé à bord de l'avion de la Garde côtière pour mesurer en temps réel la teneur en soufre des émissions des navires. De plus, l'Agence Européenne de Sécurité Maritime (AESM) a mis en place un programme de drones "sniffers" destinés à mesurer les émissions polluantes des navires dans les eaux et ports européens. Ces drones collectent des échantillons de gaz directement dans les panaches des navires, permettant une analyse en temps réel et facilitant l'identification des navires potentiellement non conformes aux réglementations environnementales.
2. Intégration des données satellitaires et de l'apprentissage automatique pour la surveillance des émissions
Des recherches récentes ont exploré l'utilisation de données satellitaires combinées à des techniques d'apprentissage automatique pour détecter les émissions anormales de NO₂ des navires. Cette approche innovante permet d'identifier les navires susceptibles de ne pas respecter les normes d'émission, en offrant une couverture étendue et une surveillance continue.
3.Adaptation du droit international et européen aux nouvelles méthodes de preuve
Le cadre juridique international a évolué pour intégrer ces nouvelles méthodes de preuve. L'Organisation Maritime Internationale (OMI), par le biais de l'Annexe VI de la Convention MARPOL, impose des limites strictes sur les émissions de polluants atmosphériques par les navires. Les États membres sont tenus de surveiller et de faire respecter ces normes, en s'appuyant sur des preuves obtenues grâce aux technologies modernes de surveillance.
B. Perspectives d'harmonisation au sein de l'Union européenne et sur le plan international
1. Efforts de standardisation des méthodes de surveillance et de rapport des émissions
Au sein de l'Union européenne, des efforts sont déployés pour standardiser les méthodes de surveillance et de rapport des émissions, notamment par le biais du règlement MRV (Monitoring, Reporting, Verification) qui établit un cadre commun pour la surveillance des émissions de CO₂ des navires.
2. Coopération internationale pour le partage des données et des meilleures pratiques
L'OMI travaille à l'élaboration de lignes directrices pour l'utilisation de technologies de surveillance à distance et encourage la coopération entre les États membres pour partager les données et les meilleures pratiques. Toutefois, des défis subsistent en raison des différences dans les capacités technologiques et les cadres juridiques nationaux.
3. Défis persistants et recommandations pour une harmonisation effective
Malgré les progrès réalisés, plusieurs défis subsistent dans l'harmonisation des méthodes de preuve de la pollution atmosphérique des navires :
-
Disparités technologiques et réglementaires : Les capacités de surveillance varient considérablement entre les États membres de l'Union européenne et au niveau international. Certains pays disposent de technologies avancées pour la détection des émissions, telles que les drones "sniffers" ou les capteurs aériens, tandis que d'autres manquent de ressources pour les déployer. Cette hétérogénéité complique l'application uniforme des réglementations.
-
Coopération internationale limitée : Bien que des initiatives existent, la collaboration entre les nations pour le partage des données et des meilleures pratiques reste insuffisante. Une coopération renforcée est essentielle pour une surveillance efficace des émissions à l'échelle mondiale.
-
Évolution des pratiques maritimes : L'apparition de "flottes fantômes", des navires opérant clandestinement pour contourner les sanctions internationales, complique la traçabilité et la surveillance des émissions. Ces pratiques augmentent les risques environnementaux et nécessitent une vigilance accrue.
Pour surmonter ces obstacles, les recommandations suivantes doivent être étudiées :
-
Standardisation des protocoles de surveillance : Élaborer des lignes directrices communes pour la surveillance des émissions, incluant des méthodes de mesure, des fréquences d'échantillonnage et des critères d'évaluation, afin d'assurer une cohérence dans la collecte et l'interprétation des données.
-
Renforcement des capacités des États membres : Fournir un soutien technique et financier aux pays disposant de ressources limitées pour les aider à adopter des technologies de surveillance modernes et à former le personnel compétent.
-
Amélioration de la coopération internationale : Créer des plateformes dédiées au partage des données sur les émissions des navires, faciliter les échanges d'informations entre les autorités maritimes et promouvoir des initiatives conjointes de recherche et de développement.
-
Mise en place de mécanismes de conformité robustes : Établir des systèmes de sanctions dissuasives pour les navires ne respectant pas les normes d'émission, tout en offrant des incitations pour encourager les pratiques exemplaires en matière de réduction des émissions.
En adoptant ces mesures, la communauté internationale pourra progresser vers une harmonisation effective des méthodes de preuve de la pollution atmosphérique des navires, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et de la santé publique.
Conclusion
La preuve de la pollution atmosphérique des navires est un enjeu complexe qui nécessite une approche multidisciplinaire, alliant expertise juridique, technique et scientifique. Les défis actuels appellent à une amélioration continue des méthodes de surveillance et à une adaptation des cadres juridiques pour garantir une protection efficace de l'environnement et de la santé publique.
Références
-
Organisation Maritime Internationale, "Réduction des émissions de carbone et lutte contre la pollution de l'air", https://www.imo.org/fr/MediaCentre/HotTopics/Pages/ghg-default.aspx
-
Parlement européen, "La pollution atmosphérique et sonore", https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/75/la-pollution-atmospherique-et-sonore
-
OD Nature, "Lutte contre la pollution de l'air par les navires", https://odnature.naturalsciences.be/mumm/fr/aerial-surveillance/combatting-air-pollution
-
"Sniffers: así son los drones 'olfateadores' para medir la contaminación marítima en Europa", El País, https://elpais.com/tecnologia/2024-08-19/sniffers-asi-son-los-drones-olfateadores-para-medir-la-contaminacion-maritima-en-europa.html
-
"Les flottes fantômes, atout stratégique de la Russie pour écouler son pétrole sous sanction", Le Monde, https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2024/10/30/les-flottes-fantomes-atout-strategique-de-la-russie-pour-ecouler-son-petrole-sous-sanction_6367064_4355770.html
-
"La baisse des émissions de soufre a une influence marginale sur le réchauffement climatique", Le Monde, https://www.lemonde.fr/planete/article/2024/08/29/la-baisse-des-emissions-de-soufre-a-une-influence-marginale-sur-le-rechauffement-climatique_6298180_3244.html

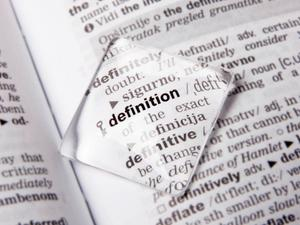
Pas de contribution, soyez le premier