L’idée de reconnaître aux baleines des droits similaires à ceux des êtres humains, telle que soutenue par le roi des Maoris en Nouvelle-Zélande, s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance de la personnalité juridique des éléments de la nature. Ce concept, bien que séduisant d’un point de vue éthique et écologique, pose d’importantes difficultés juridiques. Il remet en cause des principes fondamentaux du droit, tels que la distinction entre personnes et choses, l’imputabilité des droits et obligations, ainsi que la mise en œuvre de la responsabilité juridique.
Si certains États ont déjà accordé une reconnaissance juridique à des éléments naturels (fleuves, forêts), conférer des droits aux animaux en tant que sujets de droit reste une démarche inédite aux implications considérables. Cet article examine les enjeux d’une telle évolution, en mettant en lumière ses attraits éthiques, mais aussi ses effets pervers pour la cohérence et la stabilité des systèmes juridiques.
1. Un fondement éthique et écologique séduisant
1.1. Une avancée pour la protection des espèces menacées
La reconnaissance de droits aux baleines s’inscrit dans un mouvement plus large visant à accorder une protection juridique renforcée aux êtres vivants et aux écosystèmes. Toutefois, toutes les avancées en la matière ne se valent pas et ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Il est essentiel de distinguer les différentes approches, leurs nuances et les implications spécifiques de chacune.
a. La reconnaissance des droits de la nature : une protection élargie des écosystèmes
Certains systèmes juridiques ont opté pour une approche globale en reconnaissant des droits à des entités naturelles dans leur ensemble, sans distinction entre faune et flore. Ce modèle repose sur l’idée que les écosystèmes ont une valeur intrinsèque et doivent être protégés indépendamment de leur utilité pour l’homme.
-
L’Équateur et les droits de la nature
L'Équateur a été le premier pays à inscrire dans sa Constitution (article 71, 2008) que la nature, ou "Pachamama", possède des droits et peut être défendue juridiquement. L’objectif est de garantir la préservation des écosystèmes en permettant à des individus ou organisations d’intenter des actions en justice au nom de la nature, même en l’absence d’un préjudice humain direct. -
La Bolivie et la "loi de la Terre Mère"
Inspirée du modèle équatorien, la loi bolivienne de 2010 sur les droits de la Terre Mère confère des droits propres aux écosystèmes, en reconnaissant notamment le droit à la régénération et à l’équilibre écologique. Cependant, l’application de cette loi est restée limitée en raison d’un conflit entre les impératifs écologiques et les intérêts économiques nationaux, notamment l’exploitation minière.
Dans ces modèles, les écosystèmes sont protégés dans leur globalité, et non une espèce en particulier. L'idée est d’empêcher des actions humaines portant atteinte à l'équilibre écologique dans son ensemble.
b. La reconnaissance de droits spécifiques à des entités naturelles délimitées
Une autre approche consiste à attribuer des droits à des entités naturelles spécifiques, comme des fleuves, des forêts ou des montagnes.
-
La Nouvelle-Zélande et la rivière Whanganui (2017)
En 2017, la Nouvelle-Zélande a accordé la personnalité juridique au fleuve Whanganui, considéré comme une entité vivante par les Maoris. Deux représentants légaux ont été désignés pour défendre ses intérêts : l’un issu du peuple maori, l’autre nommé par l’État. Cette reconnaissance repose autant sur des considérations écologiques que sur des principes culturels et spirituels, les Maoris estimant que le fleuve fait partie de leur identité. -
L’Inde et la reconnaissance du Gange et du Yamuna
En 2017, la Haute Cour de l’Uttarakhand a déclaré que les fleuves Gange et Yamuna sont des entités juridiques vivantes, afin de lutter contre leur pollution extrême. Toutefois, cette décision a rapidement été contestée par la Cour suprême indienne, qui a suspendu cette reconnaissance, craignant une insécurité juridique liée aux implications économiques et industrielles de cette personnification des fleuves.
Dans ces cas, le droit conféré à ces entités vise principalement la préservation et la restauration d’un environnement précis plutôt qu’une protection généralisée de la nature. La reconnaissance d’un statut juridique permet d’établir des obligations spécifiques (nettoyage, interdiction de pollution), souvent en lien avec des revendications autochtones ou locales.
c. La reconnaissance de droits aux animaux : une approche plus ciblée et inédite
La proposition d’accorder des droits aux baleines s’inscrit dans une démarche encore plus spécifique, qui consiste à considérer certains animaux comme des sujets de droit. Contrairement aux modèles précédents qui portent sur des écosystèmes, cette reconnaissance met en avant des droits individuels attachés à des espèces précises.
-
Vers une reconnaissance des animaux comme sujets de droit ?
Si la reconnaissance de la personnalité juridique aux fleuves et aux forêts a ouvert la voie à une réinterprétation des rapports entre droit et nature, l’octroi de droits spécifiques aux animaux constitue une rupture plus radicale avec les principes juridiques traditionnels.Jusqu’à présent, la plupart des protections accordées aux animaux reposent sur leur statut d’êtres vivants sensibles, mais non sur une reconnaissance de droits subjectifs en tant que tels.
- En France, l’article 515-14 du Code civil reconnaît que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, mais ils restent soumis au régime des biens.
- En Suisse, les animaux bénéficient d’une protection plus avancée, notamment en matière de bien-être animal, mais ils ne sont pas des sujets de droit.
- En Argentine, en 2016, un tribunal a reconnu la personnalité juridique d’une orang-outan appelée Sandra, considérant qu’elle devait être protégée en tant qu’individu ayant des droits fondamentaux à la liberté et au bien-être.
- Aux États-Unis, plusieurs actions ont été intentées par des associations pour obtenir la reconnaissance de droits fondamentaux à des chimpanzés et des éléphants, mais elles ont été rejetées au motif que les animaux ne peuvent être titulaires de droits au même titre que les humains.
La reconnaissance des baleines comme sujets de droit irait donc plus loin que la simple protection animale et soulèverait des questions fondamentales sur leur capacité juridique et sur la nature même des droits qu’on leur accorde.
1.2. Une rupture avec l’anthropocentrisme du droit
Le droit occidental repose historiquement sur une distinction nette entre les personnes (titulaire de droits) et les choses (objet de droit). Or, reconnaître des droits à des êtres non humains renverse cette vision anthropocentrée, en admettant que certaines espèces ont une valeur intrinsèque, indépendamment de leur utilité pour l’homme. Cette approche peut être rapprochée des théories du droit animal, qui plaident pour l’abolition du statut d’animal-objet au profit d’un statut d’animal-sujet.
2. Les effets pervers d’une telle reconnaissance juridique
2.1. Une remise en cause des fondements du droit
Accorder aux baleines des droits semblables à ceux des humains pose une difficulté fondamentale : la capacité d’exercer ces droits et d’assumer des obligations. Dans les systèmes juridiques modernes, être titulaire de droits implique également la possibilité de répondre de ses actes. Or, les baleines, dépourvues de conscience juridique et de volonté, ne peuvent ni agir en justice, ni respecter des obligations, ni être sanctionnées. Dès lors, qui serait responsable en leur nom ? Cette question conduit inévitablement à la désignation de représentants légaux, ce qui soulève un risque de manipulation idéologique ou d’instrumentalisation judiciaire.
2.2. Une insécurité juridique pour les activités humaines
Si les baleines acquièrent des droits similaires à ceux des humains, il en découle nécessairement des restrictions accrues sur certaines activités maritimes : pêche, transport maritime, tourisme, exploitation des ressources sous-marines. Or, ces industries sont déjà soumises à des réglementations environnementales strictes, et une telle évolution pourrait mener à des contentieux nombreux et complexes. Une personnalité juridique accordée aux cétacés pourrait, par exemple, permettre d’intenter des actions en justice au nom des baleines contre des États ou des entreprises, ce qui aboutirait à une judiciarisation excessive des conflits environnementaux.
2.3. Une dilution du concept de personnalité juridique
La multiplication des entités non humaines bénéficiant d’une personnalité juridique risque d’aboutir à une perte de sens de cette notion. Déjà, la reconnaissance de la personnalité juridique à des fleuves ou des forêts a suscité des interrogations : si une rivière peut être titulaire de droits, pourquoi pas une montagne, un récif corallien, ou même l’ensemble des écosystèmes marins ? Cette inflation du nombre d’entités juridiques pourrait affaiblir la portée même du concept de sujet de droit.
3. Une alternative : renforcer la protection juridique des animaux sans leur accorder une personnalité juridique
Plutôt que d’accorder aux baleines des droits humains, une solution intermédiaire consisterait à renforcer leur protection dans un cadre juridique adapté.
3.1. Un statut juridique spécifique aux cétacés
Une solution serait d’accorder aux baleines un statut de « sujets de protection juridique », à mi-chemin entre l’objet et la personne. Un tel statut pourrait leur conférer des droits fondamentaux (droit à un habitat préservé, interdiction de la maltraitance), sans aller jusqu’à leur accorder une pleine personnalité juridique.
3.2. Une responsabilité accrue des États et des entreprises
Le droit de l’environnement pourrait être renforcé en imposant aux États et aux entreprises des obligations plus strictes de préservation des cétacés. L’instauration de sanctions dissuasives et de mécanismes de réparation environnementale permettrait d’atteindre les mêmes objectifs qu’une reconnaissance de droits humains, sans entraîner les dérives évoquées.
3.3. L’encadrement des recours judiciaires : prévenir l’inflation contentieuse et les détournements procéduraux
L’un des risques majeurs liés à la reconnaissance des animaux ou des entités naturelles comme sujets de droit réside dans l’usage judiciaire qui pourrait en être fait. La possibilité pour des représentants (associations, institutions publiques, voire individus désignés) d’agir en justice au nom de ces nouveaux sujets de droit soulève des enjeux fondamentaux en matière de sécurité juridique, de légitimité procédurale et de contrôle des recours.
a. Un risque d’inflation contentieuse et de judiciarisation excessive
Si les cétacés (ou d’autres animaux et entités naturelles) bénéficient de droits subjectifs pouvant être invoqués en justice, cela entraînera inévitablement une augmentation du contentieux environnemental. Or, plusieurs questions émergent :
-
Quels seront les critères de recevabilité des actions intentées au nom des animaux ou des écosystèmes ?
Faudra-t-il démontrer un préjudice spécifique (ex. : destruction d’habitat, pollution affectant directement une population de baleines) ou pourra-t-on agir sur la base d’une atteinte plus générale à l’environnement ? -
Qui pourra agir en justice au nom des cétacés ?
Le choix des représentants légaux est un point délicat. Si l'on accorde aux associations environnementales un pouvoir élargi, cela risque de multiplier les recours intentés par des organisations aux objectifs parfois divergents. Certains acteurs pourraient utiliser ces recours pour faire pression sur des entreprises, des États ou même des particuliers, dans une logique parfois plus idéologique que véritablement protectrice. -
Le risque de blocage de projets économiques et industriels
Si les droits des baleines sont assimilés à des droits fondamentaux (droit à un environnement sain, droit de vivre en sécurité), de nombreux projets maritimes pourraient être contestés devant les juridictions. Une forme de paralysie judiciaire pourrait en résulter, notamment si ces droits sont invoqués de manière systématique pour s’opposer à des aménagements côtiers, des activités de pêche ou de transport maritime.
b. Le risque de détournement des actions judiciaires
L’ouverture de recours élargis au nom des baleines peut également mener à des abus procéduraux ou à des stratégies d’instrumentalisation judiciaire. Plusieurs scénarios sont envisageables :
-
Utilisation des recours comme outils de lobbying judiciaire
Des groupes de pression pourraient engager des procédures non dans un but réel de protection des animaux, mais comme moyen de peser sur certaines décisions politiques ou économiques. Cette pratique, déjà observée dans le contentieux environnemental, pourrait être amplifiée si les animaux deviennent sujets de droit. -
Fragmentation des représentations et conflits entre parties prenantes
Si plusieurs associations ou acteurs revendiquent le droit de représenter les baleines, des conflits de compétence pourraient émerger. Qui aura la primauté pour agir en justice ? Une association locale de protection de la faune pourra-t-elle être supplantée par une organisation internationale ? Des contentieux secondaires sur la légitimité des représentants pourraient voir le jour, complexifiant encore le paysage judiciaire. -
Risque d’instrumentalisation politique
Certains États ou groupes économiques pourraient utiliser la reconnaissance des droits des cétacés comme un argument juridique pour limiter la concurrence dans certains secteurs maritimes. Par exemple, une nation pourrait restreindre les activités de pêche étrangères dans ses eaux en invoquant la nécessité de protéger les mammifères marins, tout en continuant à exploiter ses propres ressources.
c. Une nécessité d’encadrer strictement ces recours pour éviter une dérive procédurale
Pour éviter ces dérives, plusieurs pistes peuvent être envisagées :
-
Limiter la reconnaissance des recours aux seules associations agréées
Une sélection rigoureuse des acteurs pouvant représenter les baleines serait essentielle. Il pourrait être exigé que seules des associations agréées par les autorités publiques puissent agir en justice, sur la base de critères stricts (ancienneté, expertise scientifique, indépendance financière). -
Définir précisément les types de préjudices pouvant être invoqués
Pour éviter les recours abusifs, il conviendrait de restreindre les actions aux atteintes significatives et avérées aux écosystèmes marins. La démonstration du préjudice causé aux cétacés devrait être fondée sur des éléments scientifiques solides, afin d’écarter les recours fondés sur des revendications idéologiques ou spéculatives. -
Encadrer les sanctions et les réparations
Si des dommages sont reconnus, qui bénéficiera des indemnisations ? L’argent alloué en réparation devrait être strictement dédié à la préservation des espèces concernées, sous supervision d’autorités indépendantes, pour éviter toute captation de fonds par des acteurs peu scrupuleux. -
Instaurer un filtre judiciaire pour limiter l’encombrement des tribunaux
Un mécanisme de filtrage pourrait être mis en place pour éviter une surcharge des juridictions administratives ou judiciaires. Un juge pourrait être chargé d’évaluer en amont la recevabilité des recours, afin d’écarter les procédures manifestement infondées.
Conclusion : entre utopie juridique et solutions pragmatiques
Si l’idée d’accorder aux baleines des droits similaires à ceux des humains repose sur une intention louable, elle soulève de sérieuses difficultés d’application. Loin d’être une avancée claire, elle pourrait engendrer des conflits juridiques et économiques majeurs, tout en diluant le concept de personnalité juridique.
Plutôt que d’adopter une approche extrême, une voie intermédiaire consistant à renforcer la protection des baleines au sein du droit de l’environnement apparaît plus réaliste et efficace. La reconnaissance d’un statut juridique spécifique aux animaux menacés, combinée à une responsabilisation accrue des acteurs humains, permettrait de concilier impératif écologique et stabilité juridique.
En définitive, la protection des cétacés passe moins par une assimilation aux humains que par la mise en place de mécanismes juridiques adaptés à leur nature et à leur vulnérabilité.

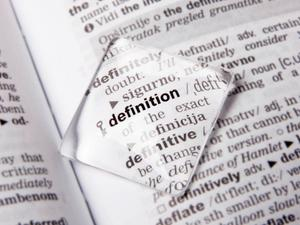
Pas de contribution, soyez le premier